Louis Hughes : Offert en cadeau de Noël
« Comme j’étais souvent malade – en fait, j’avais des frissons et de la fièvre depuis qu’il m’avait acheté – M. Reid décida de me vendre et, en octobre 1844, me ramena à Richmond et me laissa dans le bâtiment de l’Exchange, où l’on vendait les esclaves aux enchères. Les ventes se tenaient dans une grande salle ; les acheteurs intéressés s’asseyaient autour d’une grande estrade, où l’on faisait monter l’esclave mis en vente, à côté du commissaire priseur. Lorsque j’y montai, un certain M. McGee s’approcha, me tâta et me demanda ce que je savais faire. « Tu m’as l’air d’un bon nègre intelligent », me dit-il, « la Virginie a toujours produit de bons noirauds ». La Virginie était la mère de l’esclavage et beaucoup estimaient qu’on y trouvait les meilleurs esclaves. Si bien que lorsqu’il apprit que j’étais né et que j’avais grandi dans cet État, M. McGee parut satisfait.
Les enchères commencèrent et je me souviens du moment où le commissaire s’écria : « Trois cent quatre-vingts dollars, une fois, deux fois, adjugé à M. Edward McGee ! » C’était un riche planteur de coton de Pontotoc, dans le Mississippi. Pour autant que je me souvienne, je n’avais pas plus de douze ans et ne fus donc pas vendu très cher.
Les servantes se vendaient 500 à 700 dollars, et atteignaient parfois 800 dollars lorsqu’elles possédaient des qualifications spéciales. Une bonne, à l’air vif, robuste et de bonne constitution, se vendait 1000 à 1200 dollars. Une jeune mulâtresse vive, sachant coudre et tricoter, pouvait atteindre 1800 dollars, surtout si elle venait de Virginie ou du Kentucky. Un bon forgeron, 1600 à 1800 dollars. Lorsque les esclaves montaient sur l’estrade, ils étaient toujours adjugés au plus offrant. M. McGee, «Boss», comme j’appris vite à l’appeler, avait acheté soixante autres esclaves avant moi, qui étaient partis en troupe vers Atlanta, en Géorgie, à pied.
Boss, moi-même et dix autres esclaves les retrouvâmes là-bas. Puis nous partîmes pour Pontotoc, dans le Mississippi. En chemin, nous fîmes halte à Edenton, en Géorgie, où Boss vendit vingt et un des soixante esclaves. Nous continuâmes notre chemin, Boss en train et nous à pied ou en charrette. Nous parcourions environ vingt miles par jour. Je me souviens que sur la route tous les hommes blancs que nous rencontrions s’écriaient « Vive Polk et Dallas ! ». Ils se réjouissaient du résultat des élections. L’homme qui nous conduisait se joignait à leur vivats. Nous avions peur de leur demander la raison de leurs cris car cela serait passé pour de l’impertinence et nous aurions tous été fouettés.
Enfin, après un long voyage épuisant, nous atteignîmes Pontotoc, là où vivait McGee, le soir de Noël. Boss me conduisit à l’intérieur de la maison, dans le salon, où toute la famille s’était rassemblée, et m’offrit en cadeau de Noël à la dame, son épouse.
Je me souviens de mon maître comme d’un homme grand et maigre mais d’apparence assez distinguée, au port élégant, d’une intelligence brillante, et qui était considéré comme l’un des planteurs les plus riches et les plus prospères de son époque. Mme McGee était une belle femme imposante, d’environ trente ans, au teint de brune, aux traits parfaits et aux manières impériales. Je pense qu’ils étaient d’origine écossaise. Ils avaient quatre enfants, Emma, Willie, Johnnie et Jimmie. Tous me regardèrent et trouvèrent que j’avais l’air d’un « petit gars débrouillard ». J’étais très timide et parlais peu, car tout me paraissait étrange. On me fit dormir cette nuit-là sur un grabat dans la salle à manger, avec un vieux dessus de lit en guise de couverture. Le lendemain était le jour de Noël et, selon la coutume, on buvait du lait de poule avant le petit-déjeuner. Ce breuvage était nouveau pour moi et sa préparation m’intéressait. Je les vis battre les blancs d’œufs dans un plat creux, jusqu’à ce qu’ils forment une mousse compacte ; on battait ensuite vigoureusement les jaunes dans un grand bol, on y ajoutait du sucre et beaucoup de bon brandy, puis on incorporait les blancs et la crème et on râpait un peu de muscade sur le dessus lorsqu’on remplissait les verres pour le service. C’était une boisson délicieuse et, surtout, abondante. Je servis toute la famille et, comme il y avait aussi de nombreux parents venus en visite, il fallait de beaucoup de verres ; le plateau me semblait si lourd que j’arrivais à peine à le porter. J’en bu à mon tour, à la fin du service, et fus ravi : je n’avais jamais rien goûté d’aussi délicieux.
Mon chef me dit que je devais servir sa femme et faire toutes les courses dont on me chargerait ainsi que le service dans la salle à manger – en fait, j’étais le garçon à tout faire. C’était différent du mode de vie calme que j’avais connu avant d’arriver là – cela me fit d’ailleurs garder le moral un certain temps. Je pensais souvent à ma mère, mais je m’habituai peu à peu à l’idée qu’il était inutile de pleurer et m’efforçai de surmonter mon chagrin.
Comme je l’ai déjà dit, c’était le matin de Noël. Après le petit-déjeuner, je vis la cuisinière se dépêcher et, en sortant dans la cour, des esclaves de toutes parts. Je n’en avais jamais vu autant. Les fermes de Virginie n’étaient pas aussi grandes. Il n’y avait pas de grandes plantations de coton comme dans le Mississipi. Je n’oublierai jamais le repas de ce jour-là – un festin de roi, tant le menu était somptueux et varié. Mon attention fut aussi attirée par les esclaves de la ferme, à qui l’on distribuait leurs rations de Noël. Chacun recevait une pinte de farine, pour faire des petits pains qu’ils appelaient des « Billy Rarement », parce qu’ils en mangeaient très rarement. Leur nourriture quotidienne se composait de pain de maïs, qu’ils surnommaient « Jimmy Constant », car ils en mangeaient tout le temps. En plus de la farine, chacun recevait une ration de lard ou de viande grasse, qui fournissait le gras pour faire les petits pains.
Ils utilisaient aussi la couenne grillée qui restait quand le lard avait fondu comme matière grasse. Les ouvriers avaient droit à quatre jours de congé à Noël et, s’ils travaillaient ces jours-là, comme certains le faisaient, ils recevaient cinquante cents par jour pour l’arrachage. Habituellement, on n’arrachait pas les cotonniers pendant les vacances mais certains planteurs trouvaient utile de le faire à ce moment-là, pour pouvoir se consacrer ensuite aux travaux qui venaient après Noël.»
Louis Hughes, Thirty Years a Slave : From Bondage to Freedom : The Institution of Slavery as Seen on the Plantation and in the Home of the Planter, Milwaukee, South Side Printing Company, 1897, p. 11-16. Traduction française Hélène Tronc, tous droits réservés.
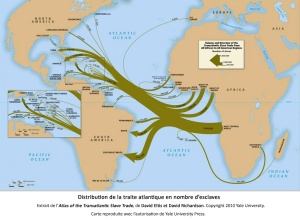
Commentaires fermés