Henry Bibb : Un insatiable désir de liberté
« Je suis né en mai 1815, propriété de M. David White, d’une mère esclave, dans le comté de Shelby dans le Kentucky. White était entré en possession de ma mère longtemps avant ma naissance. J’ai grandi dans les comtés de Shelby, Henry, Oldham et Trimble, ou, plus précisément, j’y ai grandi à coups de fouet ; car au lieu d’une instruction morale, intellectuelle et religieuse, j’ai reçu d’innombrables coups de fouet qui visaient à me dégrader et à me maintenir dans un état de subordination. Je peux affirmer sans mentir que j’ai bu abondamment à la coupe amère de la souffrance et de la misère. J’ai été abaissé jusqu’aux bas-fonds de la déchéance et du malheur humains.
Ma mère était connue sous le nom de Milldred Jackson. Elle n’est mère que de sept esclaves, tous des garçons, dont je suis l’aîné. Elle avait aussi la chance, ou la malchance, d’avoir ce qu’on appelle du sang esclavagiste dans les veines. J’ignore dans quelles proportions ; trop faibles de toutes façons pour empêcher ses enfants d’être vendus et achetés sur les marchés d’esclaves du Sud, malgré des pères propriétaires. Il est presque impossible pour les esclaves de rendre compte correctement de leur lignée paternelle. Tout ce que je sais de la mienne est que ma mère m’a dit que mon père se nommait James Bibb. Il appartenait sans aucun doute à la famille Bibb qui vit encore aujourd’hui dans le Kentucky mais je ne le connais pas du tout personnellement car il est mort avant la date à laquelle remontent mes premiers souvenirs.
La première fois que l’on m’a séparé de ma mère, j’étais tout petit. Je ne savais encore rien de ma condition d’esclave. Je vivais avec M. White, resté veuf et père d’une petite fille après la mort de sa femme. Cette fillette était la propriétaire légale de ma mère et de tous ses enfants. Elle était ma camarade de jeux quand nous étions enfants.
J’ai été séparé de ma mère et loué à diverses personnes pendant huit ou dix ans d’affilée ; tout l’argent que je rapportais servait à l’éducation de Harriet White, ma camarade de jeux. C’est à cette époque que sont nés mes chagrins et mes souffrances. C’est à cette époque que j’ai commencé à comprendre et à ressentir que j’étais un misérable esclave, obligé de travailler sous le fouet, sans rétribution et souvent sans vêtements pour cacher ma nudité. Je travaillais souvent le ventre presque vide, très tard le soir et très tôt le matin, de jour comme de nuit. Je devais reposer mes membres fatigués à même la terre ou sur un banc, la nuit, sans rien pour me couvrir, parce que je n’avais pas d’autre endroit où coucher mon corps épuisé par le labeur d’une longue journée. J’ai aussi été forcé, dès mes premières années, d’obéir aux moindres caprices d’un tyran, par tous les temps, chaud, froid, sec, humide, et souvent sans chaussures jusqu’au mois de décembre, marchant sur le sol froid et givré, les pieds crevassés et en sang. Lecteur, crois-moi quand je dis qu’aucune langue, qu’aucune plume n’a pu ni ne pourra dire l’horreur de l’esclavage américain. Je désespère de trouver un langage capable d’exprimer les sentiments profonds de mon âme quand je contemple l’histoire de ma vie. Mais même si j’ai beaucoup souffert du fouet, de la faim et du manque d’habits, je reconnais que ce ne fut pas un handicap de passer entre les mains de tant de familles car l’unique source d’information qui pouvait éclairer mon esprit, c’est ce que je voyais et entendais chez les autres. Livres, plumes, encre et papier étaient interdits aux esclaves pour perfectionner leur esprit. Mais il me semble aujourd’hui que j’étais très observateur et que je retenais bien ce que je voyais. Surtout, je n’oubliais jamais ce que j’entendais sur la liberté des esclaves. Entre autres talents profitables, j’ai appris l’art de la fuite à la perfection. J’en avais fait une activité régulière et je n’y ai jamais renoncé avant d’avoir brisé les liens de l’esclavage et d’atteindre sain et sauf le Canada, où l’on m’a considéré comme un homme et non comme une chose.
La première fois, en 1825, je me suis enfui parce que j’avais été maltraité. Je vivais chez un certain M. Vires, dans le village de Newcastle. Son épouse était très colérique. Elle me fouettait chaque jour, me rouait de coups, me tirait les oreilles et me grondait tant que j’avais très peur d’entrer dans la pièce où elle se trouvait. Cela m’incita pour la première fois à fuir loin d’eux. Je réussissais souvent à m’échapper plusieurs jours avant d’être repris. Ils me battaient pour me punir d’être parti mais cela ne servait à rien. Dès qu’ils recommençaient à me fouetter, je reprenais la fuite. Après quelque temps, ils estimèrent qu’ils n’avaient pas fait une bonne affaire et me retournèrent à mes premiers propriétaires. M. White avait alors épousé sa seconde femme. Elle était ce que j’appellerais un tyran. J’ai vécu à ses côtés plusieurs mois mais je passais près de la moitié de mon temps dans les bois pour éviter ses coups de fouet sanglants. Quand j’étais à la maison, elle m’obligeait à cirer les meubles, à laver et à frotter les sols ; ou elle s’asseyait dans un grand fauteuil à bascule sur deux coussins et je devais la balancer en éloignant les mouches. Elle était trop fainéante pour se gratter elle-même la tête et me demandait souvent de le faire et de lui peigner les cheveux. Parfois, elle s’allongeait sur son lit, quand il faisait chaud, et je devais l’éventer pendant qu’elle dormait ou lui gratter et lui frotter les pieds ; mais au bout d’un certain temps elle se lassa de moi et préféra confier ces tâches à une bonne. Je fus à nouveau loué à l’extérieur mais j’étais devenu bien plus habile à m’enfuir et j’inventais des stratagèmes pour éviter d’être découvert. J’emportais des rênes par exemple. Si l’on m’apercevait dans les bois, comme c’est arrivé, et qu’on me demandait « Que faites-vous ici monsieur ! Êtes-vous un fugitif ? », je répondais « Non monsieur, je suis à la recherche de notre vieille jument » ou « Je cherche nos vaches ». Grâce à ces excuses, on me laissait passer. En fait, la seule arme d’auto-défense à ma disposition était la tromperie. Il est inutile pour un pauvre esclave sans ressources de résister à un homme blanc dans un État esclavagiste. L’opinion publique et la loi sont contre lui ; et dans bien des cas résister signifie mourir, car la loi affirme que l’esclave devra se soumettre ou périr.
Les conditions dans lesquelles je me trouvais alors m’ont donné un insatiable désir de liberté. Elles ont allumé dans ma poitrine une flamme de liberté qui ne s’est jamais éteinte. Cela semblait faire partie de ma nature ; j’en eus d’abord la révélation grâce aux lois inéluctables du Dieu de la nature. Je voyais que le Créateur dans sa Sagesse infinie avait fait de l’homme un être libre, moral, intelligent et responsable, capable de connaître le bien et le mal. Et je croyais, et je crois toujours, que tout homme a droit à un salaire pour son travail ; a le droit d’avoir sa propre femme et ses propres enfants ; a droit à la liberté et à la poursuite du bonheur ; a le droit de vénérer Dieu selon les impératifs de sa propre conscience. Or malgré ces vérités j’étais un esclave, un prisonnier à vie ; je ne pouvais ni posséder ni acquérir quoi que ce soit qui n’appartienne à mon maître. Personne ne peut imaginer ce que je ressentais lorsque je réfléchissais ; seul celui qui a été lui-même esclave le peut. Oh ! Combien j’ai pleuré sur ma condition tandis que j’arpentais la forêt pour échapper à de cruels châtiments.
« Nul bras pour me protéger de l’agression des tyrans ;
Nul parent pour me réconforter quand le chagrin m’accable.
On peut tracer les contours des rochers et des rivières,
Des collines et des vallées, des lacs et de l’océan,
Mais les horreurs de l’esclavage, nul ne pourra jamais les peindre. »
Aujourd’hui encore, mon âme résonne de terreur au mot « esclave » – un mot trop odieux pour être prononcé, un système trop intolérable pour être supporté. Une longue et triste expérience me l’a enseigné. J’ai l’impression de me réveiller tout juste et de regarder en accéléré les tourments que j’ai fuis. Là-bas, j’étais détenu et possédé comme esclave ; en tant que tel, j’étais soumis à la volonté et au pouvoir de mon maître, à tous égards. Personne ne peut nier qu’un esclave soit un être humain. Il est soumis au même sort que les autres hommes : les catastrophes de la maladie, la mort, les infortunes qui font partie de la vie. Mais, à l’inverse des autres hommes, il n’a pas la consolation de pouvoir lutter contre les difficultés qui l’assaillent et qui brisent sa vie, sa liberté et le bonheur de sa famille et le sien. Un esclave peut être acheté ou vendu au marché comme un bœuf. Il peut être vendu très loin de sa famille. Ses mains et ses pieds sont enchaînés ; ses souffrances sont décuplées par la pensée terrible qu’il n’a pas le droit de lutter contre son infortune, contre les punitions corporelles, les insultes et les outrages qui lui sont infligés, à lui et à sa famille ; il n’a pas le droit de s’aider lui-même, de résister, de fuir le coup qui menace de s’abattre sur lui.
La conscience de cette impuissance totale, de ces chaînes perpétuelles, est la plus perturbante car elle n’est pas prête de disparaître, même chez les générations lointaines. »
Henry Bibb, Narrative of the Life and Adventures of Henry Bibb, an American Slave, Written by Himself, New York, 1849, p. 13-19. Trad. fr. Hélène Tronc. Tous droits réservés.
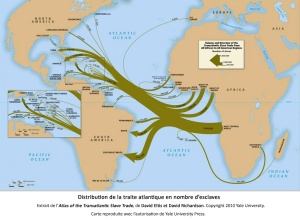
Commentaires fermés