William Craft : Un plan de fuite très audacieux
« Ma femme avait été arrachée à sa mère dès son plus jeune âge et emmenée très loin. Elle avait vu tant d’enfants séparés de leur mère de cette manière cruelle que la simple idée de devenir mère à son tour et de mener une vie misérable jusqu’à sa mort dans le système damné de l’esclavage américain emplissait son âme d’horreur ; et comme je trouvais qu’elle se faisait une idée juste de sa condition, je n’ai d’abord pas insisté pour qu’elle m’épouse mais ai accepté de l’aider à concevoir un plan qui nous permettrait de fuir et de nous marier ensuite.
Nous en avons élaboré des dizaines mais ils semblaient tous remplis d’insurmontables obstacles. Nous savions qu’il était illégal pour tout transport public de nous prendre comme passagers sans le consentement de notre maître. Nous savions aussi parfaitement que si nous partions sans son autorisation, les chasseurs d’esclaves professionnels auraient tôt fait de lancer leurs limiers à nos trousses et que nous serions de nouveau réduits en esclavage, mais cette fois dans une situation moins favorable : nous serions séparés l’un de l’autre pour toujours et affectés aux travaux les plus durs et les plus pénibles ou torturés à mort pour servir d’exemples et terroriser d’autres esclaves afin de les dissuader de fuir. Rien ne semble donner autant de plaisir aux propriétaires d’esclaves que de capturer et de torturer des fugitifs. Ils préfèrent de loin manier leur fouet zélé et pernicieux et lacérer la chair de leurs victimes tremblantes au point de la réduire en atomes qu’en laisser un seul fuir vers la liberté et révéler l’infâme système qu’il a fui.
L’excitation est à son comble lors des chasses aux esclaves. Les propriétaires et les brutes qu’ils engagent semblent prendre plus de plaisir à ces poursuites inhumaines que les sportsmen anglais à chasser le renard ou le cerf. Sachant donc ce que nous risquions d’endurer si nous étions pris et ramenés, nous voulions forger un plan qui nous conduirait sains et saufs vers la liberté.
Après des années de réflexion, nous en sommes arrivés à la triste conclusion qu’il était presque impossible de fuir l’esclavage en Géorgie et de parcourir les mille cinq cents kilomètres nécessaires pour traverser les États esclavagistes. Nous décidâmes donc de demander à nos maîtres la permission de nous marier, de nous résigner à l’esclavage et de tout faire pour améliorer notre situation au sein de ce système, tout en guettant les moindres espoirs de liberté et en suppliant Dieu de nous aider à fuir cette injuste servitude.
Nous nous sommes mariés. Nous priâmes et trimâmes jusqu’au mois de décembre 1848 ; à ce moment-là, comme je l’ai dit, un plan nous vint. Ce fut une pleine réussite puisque huit jours après en avoir eu l’idée, nous étions délivrés des horribles griffes de l’esclavage et glorifiions Dieu qui nous avait permis d’échapper à notre captivité.
Sachant que les propriétaires jouissent du privilège d’emmener leurs esclaves dans toutes les parties du pays où ils jugent bon d’aller, j’eus l’idée d’aider ma femme à se travestir en propriétaire invalide puisqu’elle était presque blanche : elle se ferait passer pour mon maître, tandis que moi je la servirais comme si j’étais son esclave, et nous réussirions ainsi à nous échapper. Je lui fis part de mon plan mais elle refusa d’abord. Elle estimait qu’il était à peu près impossible pour elle de se déguiser ainsi et de parcourir mille cinq cents kilomètres dans les États esclavagistes. Mais elle réfléchissait aussi sur sa condition. Elle voyait que les lois sous lesquelles nous vivions ne la reconnaissaient pas comme une femme mais comme une simple marchandise qui pouvait être vendue, achetée ou négociée selon la volonté de son maître. Plus elle contemplait son sort désespéré, plus elle était impatiente d’y échapper. Elle finit par me dire : « Je pense que c’est presque trop difficile pour nous mais je sens que si Dieu nous accompagne et nous aide, nous réussirons malgré tous les obstacles. Si tu achètes le déguisement, j’essaierai d’exécuter le plan. »
J’étais donc décidé à acheter le déguisement mais j’avais peur de demander qu’on me vende les articles nécessaires. En Géorgie, il est illégal pour un Blanc de commercer avec un esclave sans le consentement de son maître. Cela n’empêche pas de nombreuses personnes de vendre à un esclave tout ce qu’il peut acheter. Non par sympathie mais simplement parce que le témoignage d’un esclave contre une personne blanche n’est pas reconnu en justice.
Je pus donc sans mal me rendre à différents endroits de la ville, par intermittence, et acheter le déguisement pièce par pièce (hormis les pantalons, que ma femme préférait fabriquer elle-même) et à les apporter dans la maison où elle vivait. Comme elle était une bonne et très appréciée de sa famille, elle disposait d’une petite pièce à elle ; pendant mon temps libre, je lui avais fabriqué une petite commode ; quand je lui apportais les articles, elle les cachait soigneusement dans ses tiroirs. Personne n’était au courant. Lorsque nous jugeâmes que tout était prêt, nous arrêtâmes le jour de notre fuite. Nous savions qu’il ne servirait à rien de nous mettre en route sans un laissez-passer de notre maître nous autorisant à nous absenter quelques jours. Sans ces papiers, nous aurions vite été repris et nous n’aurions sans doute jamais retrouvé une bonne occasion de fuir.
Les meilleurs propriétaires accordent à leurs esclaves favoris quelques jours de congés au moment de Noël ; avec beaucoup de persévérance, ma femme obtint un laissez-passer de sa maîtresse. L’ébéniste chez qui je travaillais me donna lui aussi ce papier, tout en insistant pour que je revienne au plus vite car il avait besoin de moi. Je l’ai remercié très poliment ; je n’ai malheureusement pas encore trouvé le temps de retourner là-bas ; le bon air de la liberté anglaise fait tant de bien à ma femme, à nos chers petits et à moi-même qu’il est peu probable que nous retournions de sitôt sous le régime des chaînes et du fouet.
A mon arrivée chez elle, ma femme me montra son laissez-passer et moi le mien, mais à l’époque aucun de nous deux n’était capable de les lire. Il est non seulement illégal d’apprendre à lire à un esclave mais, dans certains États, le châtiment peut aller jusqu’à une amende ou à l’emprisonnement pour toute personne qui aurait eu la bonté de violer cette prétendue loi. […]
Nous nous sommes d’abord réjouis d’avoir obtenu la permission de nous absenter quelques jours ; puis ma femme réalisa soudain que les voyageurs devaient inscrire leur nom sur les registres des hôtels ainsi que sur celui de la douane à Charleston, en Caroline du Sud, et notre moral s’effondra.
Nous étions assis dans notre petite pièce, au bord du désespoir, lorsque ma femme releva la tête et s’exclama avec un sourire succédant aux pleurs : « Je crois que j’ai trouvé ! Je vais me faire un cataplasme, mettre mon bras droit en écharpe et demander poliment aux préposés d’écrire mon nom à ma place. » Il me semblait que cela fonctionnerait.
Elle pensa ensuite que la douceur de son visage risquait de la trahir ; elle décida donc de fabriquer un autre cataplasme et de se l’appliquer sous le menton et sur les joues grâce à un mouchoir blanc noué sur le dessus de la tête. L’expression de son visage et son menton imberbe étaient presque entièrement dissimulés. Le cataplasme ne figure pas sur la gravure parce qu’il aurait nui à la ressemblance.
Sachant qu’elle se trouverait souvent en compagnie masculine, elle décida qu’il lui fallait quelque chose devant les yeux ; je suis donc allé acheter une paire de lunettes vertes au magasin. C’était le soir.
Nous sommes restés éveillés toute la nuit pour discuter de notre plan et faire les derniers préparatifs. Juste avant l’heure du départ, au matin, je lui ai coupé les cheveux pour qu’ils tombent droits sur la nuque et l’ai aidée à revêtir son déguisement et à se tenir droite. Je trouvais qu’elle faisait un gentleman fort respectable.
Ma femme n’avait aucune envie de se travestir ainsi et ne l’aurait pas fait s’il avait été possible d’atteindre la liberté par de plus simples moyens ; mais nous savions qu’il n’était pas courant dans le Sud que les femmes voyagent avec des hommes esclaves et que malgré son teint très clair, elle aurait du mal à se faire passer pour une femme blanche accompagnée de son esclave ; le fait qu’elle ne sache pas écrire aurait de toute façon voué ce plan à l’échec. Il nous était impossible de voyager sans une autorisation écrite de notre maître. Or ces autorisations ne permettaient jamais de se rendre dans un État libre. Emmitouflée dans ses cataplasmes, ma femme aurait une bonne excuse pour éviter les conversations qu’affectionnent les voyageurs yankees.»
William Craft, Running a Thousand Miles for Freedom; or, the Escape of William and Ellen Craft from Slavery, Londres, William Tweedie, 1860, p. 27-32. Trad. fr. Hélène Tronc. Tous droits réservés.
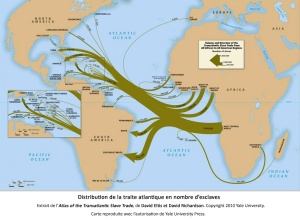
Commentaires fermés