John Brown : Le cas tragique de John Morgan, planteur et antiesclavagiste
« Avant de raconter la suite de mes aventures, je vais évoquer quelques faits qui aident à mieux comprendre le fonctionnement du système esclavagiste.
Je ne pense pas que le public sache vraiment ce qu’est l’esclavage. Il n’en mesure pas toute l’horreur et ignore qu’il affecte aussi bien les personnes libres que celles qui sont asservies. Aujourd’hui, la situation des blancs pauvres dans les États esclavagistes est pire qu’elle le sera jamais dans les États libres, parce que dans les premiers il est honteux de travailler, au point qu’un homme se refuse à cultiver ses propres champs par crainte d’être méprisé. Dans les cas fréquents où ces blancs démunis n’arrivent pas à gagner leur vie honnêtement, ils demandent aux esclaves des environs de voler leurs maîtres, pour leur fournir du maïs, des volailles et d’autres denrées – mais surtout du maïs. Les esclaves volent parce qu’ils sont mal nourris. Et comme ils savent pertinemment qu’il leur est impossible de moudre le maïs qu’ils dérobent sans risquer de se faire prendre, ils sont heureux de marchander pour recevoir jusqu’à la moitié du produit de leur rapine en farine. Ces pratiques sont très répandues et, les deux parties ayant intérêt à garder le secret, les maîtres découvrent rarement ce qu’on leur vole. Je n’ai jamais considéré le vol comme un crime puisque ce que je volais n’était qu’une partie de ce qui m’était dû. En revanche, lorsque le maître me confiait ses biens, qu’il s’agisse d’argent, de bétail ou de quoi que ce soit d’autre, je me faisais toujours une fierté d’en tenir le compte exact.
L’esclavage rend aussi les propriétaires d’esclaves jaloux de tous ceux qui emploient des hommes libres et ils n’hésitent pas à les anéantir. Ils parviennent en général à leurs fins, d’une manière ou d’une autre. Je vais illustrer ce point par une histoire qui fut portée à ma connaissance.
John Morgan, un homme grand et robuste, originaire d’Écosse, était venu s’installer dans le comté de Baldwin, sur un domaine jouxtant la plantation de Stevens. J’avais passé dix ans chez Stevens lorsque Morgan arriva dans notre voisinage. Il n’aimait pas l’esclavage, même s’il n’était pas à proprement parler un abolitionniste. Bien décidé à se passer d’esclaves, il n’embaucha que des hommes libres, blancs et de couleur, qu’il rémunérait normalement, selon les accords qu’ils avaient passés. Sa réussite surpassa de loin celle de tous les planteurs qui l’entouraient. Son coton était de bien meilleure qualité, et se vendait plus cher. Il n’obligeait pas ses ouvriers à cueillir le coton quand il était mouillé, si bien que ses fibres étaient plus propres. Il gagna beaucoup d’argent.
Tous les habitants des environs savaient qu’il pensait que les hommes libres travaillaient mieux et rapportaient plus que les esclaves. C’était un homme bon, d’un naturel aimable et chrétien, qui s’adressait toujours avec gentillesse aux noirs comme aux blancs. Les planteurs le jalousaient, parce qu’il obtenait toujours la meilleure part du marché, et ils se mirent à le calomnier. Ils affirmaient qu’il allait « pourrir tous leurs nègres, nuire à la colonie, faire du tort à l’esclavagisme », et qu’il fallait donc se débarrasser de lui. Ils prirent l’habitude de se réunir régulièrement pour discuter de son cas. Nous, esclaves, savions qu’ils tramaient quelque chose mais ne disions rien. Ils finirent par en parler à Stevens. Ils lui demandèrent d’essayer de « se débarrasser » de Morgan. Stevens répondit qu’il allait réfléchir aux solutions. Quelques jours après, il les informa qu’il avait un plan. Il allait acheter les terres de Morgan. L’idée devait leur plaire puisqu’ils se réjouirent et repartirent en riant et en plaisantant. Mais Morgan ne tomba pas tout de suite dans le piège. Il refusa de vendre ses terres, dont il tirait un bon revenu. Stevens doubla son offre. Le poisson mordit à l’appât et fut payé en billets d’ordre. Peu après la vente, Morgan quitta sa ferme, située sur son terrain, pour une maison moins grande, au sommet d’une colline proche, loin de toute habitation mais toujours dans le voisinage des plantations. Il découvrit bientôt qu’il avait été dupé car lorsque les billets qu’on lui avait remis arrivèrent à échéance, les signataires ne tinrent pas leurs engagements et il ne reçut pas l’argent promis. Il alla les trouver pour se plaindre mais ils lui rirent au nez ; et lorsqu’il menaça de les assigner en justice, ils le mirent au défi de le faire. Ils savaient qu’ils pouvaient tenir le tribunal à leur solde.
Morgan saisit donc la justice et intenta des procès à ses débiteurs. Ceux-ci soudoyèrent les magistrats et les prédisposèrent contre le plaignant en leur disant que c’était un ami des nègres, si bien qu’il ne bénéficia pas d’une audience impartiale. Ils firent traîner les procès, jusqu’à ce que les ressources de Morgan s’épuisent. Celui-ci fut alors renvoyé du tribunal, puisqu’il n’avait plus les moyens de poursuivre. Il fut ainsi complètement ruiné.
Privé de source de revenus, Morgan fut donc contraint d’imiter les autres blancs pauvres, c’est-à-dire de dépendre principalement des gens de couleur. Un jour, il vint à l’arrière de notre ferme, alors que nous labourions. Un certain Jack, un esclave, dirigeait l’équipe. Lorsque celui-ci fit tourner les chevaux, Morgan frappa la barrière avec un bâton, pour capter son attention. Jack s’arrêta et Morgan lui demanda s’il pouvait lui procurer un peu de maïs. Jack accepta et ils convinrent qu’il le lui apporterait une nuit, à un certain endroit, dans un sac de jute. Morgan s’en alla. Jack voulut se faire aider et sollicita un dénommé March, en lui promettant une partie du maïs. March accepta mais il avertit Stevens, en espérant se faire bien voir de lui et recevoir à l’avenir moins de coups de fouet. Stevens put donc élaborer un plan.
Environ trois jours plus tard, Stevens me fit venir. C’était le soir, il faisait déjà assez sombre. Il n’y avait pas de lune mais les étoiles brillaient vivement. Il tenait son fusil à la main et m’ordonna de me munir d’un gourdin de hickory et de le suivre. Nous marchâmes jusqu’à un endroit précis de la grand-route, où nous pénétrâmes dans les fourrés pour nous cacher. Une demi-heure plus tard, nous entendîmes des bruits de pas. J’avais reconnu Jack et savais qu’il transportait une charge. Il s’arrêta près de notre cachette et nous vîmes le sac de maïs. Il le posa mais notre attention fut attirée ailleurs. Nous entendîmes une autre personne approcher. Je me sentais mal car je savais que c’était Morgan et qu’il y aurait une lutte. Dès que celui-ci parvint à la hauteur de Jack, mon maître m’aiguillonna avec la pointe de son fusil et me chuchota de jaillir des fourrés pour capturer Morgan. J’étais obligé d’obéir : il avait une arme et allait me tirer dessus si je n’obéissais pas. Dès qu’il entendit du bruit dans les buissons, Jack s’enfuit. Quelques instants plus tard, je m’étais saisi de Morgan. Le malheureux se débattit de toutes ses forces mais Stevens se tenait près de moi et me criait de ne pas le lâcher, tout en surveillant notre lutte. Je ne sais pas s’il pensa que Morgan parviendrait à s’échapper mais soudain, alors que nous luttions toujours corps à corps, Stevens abaissa son fusil et tira. Je crus que j’avais été touché tellement la détonation et la fumée étaient proches mais au même moment Morgan eut un sursaut et s’écroula sur la route, en criant, face contre terre. »
John Brown, Slave Life in Georgia : A Narrative of the Life, Sufferings, and Escape of John Brown, a Fugitive Slave, Now in England, Londres, 1855, p. 53-59. Traduction française Hélène Tronc. Tous droits réservés.
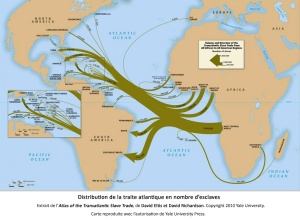
Commentaires fermés