Lewis Garrard Clarke : Sévices
« La famille comptait plusieurs enfants et ma tâche principale était de les servir. Un autre jeune esclave et moi-même devions souvent veiller toute la nuit à tour de rôle pour balancer le berceau d’un de ces rejetons esclavagistes grincheux. Si le mouvement cessait, dès qu’ils se réveillaient, ils prévenaient père ou mère par leurs cris que Lewis s’était endormi. La mère répondait à ces petits tyrans en leur suggérant de se lever, d’aller chercher le fouet et de fouetter sans retenue ce coquin de bon à rien. Voilà à quoi s’adonnaient des enfants de dix ou douze ans à minuit. Que pouvait-on attendre d’eux adultes ?
Parmi les esclaves de cette famille, nous étions quatre domestiques et si notre travail était loin d’être aussi pénible que celui des ouvriers agricoles, notre condition était à maints égards bien pire. Nous étions sans cesse exposés aux caprices et aux passions de tous les membres de la famille ; du plus petit au plus grand, c’est sur nous qu’ils assouvissaient leur colère. Et notre vie n’avait rien de reposant, ni par le nombre d’heures de labeur ni par la quantité de travail réalisée. Nous devions toujours attendre pour dormir que toute la famille se soit retirée ; il fallait être levé dès l’aurore en été et avant le lever du jour en hiver. Si nous manquions d’apparaître dès les premières sommations matinales, à cause de la fatigue ou pour toute autre raison, nous étions sûrs qu’une fustigation sévère améliorerait notre ouïe. Il m’arrivait d’être tellement terrifié à l’idée de manquer le premier appel du matin que j’ai souvent rêvé que j’entendais ce cri redouté : je me levais de ma couche, je traversais la maison et je me réveillais dehors. Pendant mon sommeil, je suis déjà allé trouver d’autres esclaves pour leur demander s’ils n’avaient pas entendu le maître appeler. Jamais, tant que je vivrai, le souvenir de ces longues nuits amères ne s’effacera de mon esprit.
Mais je voudrais vous livrer quelques exemples des sévices que l’on m’infligeait. En dix ans passés avec Mme Banton, je ne pense pas qu’il se soit écoulé dix jours, si elle était à la maison, sans qu’elle ne nous frappe ou ne nous maltraite de ses mains, moi ou un autre esclave. Elle semblait incapable de vivre sans un dos à vif, une tête bourdonnante de douleur, des yeux remplis de larmes dans son entourage. Même ses tendres indulgences étaient cruelles. Elle élevait ses enfants pour qu’ils imitent son exemple. Deux d’entre eux manifestèrent un certain dégoût pour les cruautés enseignées par leur mère mais ils n’eurent jamais sa préférence ; tout ce qui ressemblait à de l’humanité ou à de la gentillesse envers un esclave passait à ses yeux pour un grand crime.
Ses instruments de torture favoris étaient une lanière de cuir cru ou un faisceau de baguettes de hickory durcies dans le feu. Quand elle ne les avait pas sous la main, tout était bon. Une chaise, un balai, des pincettes, une pelle, des cisailles, un manche de couteau ou le lourd talon de son chausson lui convenaient aussi pour frapper : elle se montrait tellement zélée dans ces punitions barbares qu’elle faisait preuve d’une inventivité merveilleusement vive et trouvait aussitôt le moyen d’infliger le supplice adéquat.
L’un de ses instruments de torture mérite une plus ample description. C’était une canne en chêne, longue d’un pied et demi, et épaisse d’un pouce et demi. Elle utilisait cette arme délicate pour nous frapper les mains et les pieds jusqu’à ce qu’ils fussent couverts de cloques. Elle la conserva précieusement pendant quatre ans. Et durant cette période, je fus contraint de voir tous les jours cet instrument de cruauté si abhorré posé sur une chaise à côté de moi. Au moindre manquement, si le travail imposé n’était pas terminé, si notre mine ou notre comportement déplaisaient, nous étions roués de coups avec cette canne en chêne. Elle conservera toujours une place éminente dans le tableau des horreurs vécues en plus de vingt ans de servitude amère.
Un soir, quand j’avais environ neuf ans, on m’envoya dehors capturer et tuer une dinde. Elles dormaient paisiblement dans un arbre, leur retraite habituelle pour la nuit. Je m’approchai à pas feutrés, choisis ma victime mais juste au moment où je tendais la main pour l’attraper, mon pied glissa et la dinde quitta l’arbre et s’enfuit hors de portée. Je rentrai le cœur gros et fis à ma maîtresse le récit de ma mésaventure. Elle devint folle de rage. Elle décida aussitôt que je devais subir une flagellation, de la pire sorte, et voulut à tout prix aggraver mon sort. Le maître était allé se coucher, ivre, et dormait déjà du sommeil profond des ivrognes. Il remplissait la maison du bruit de ses ronflements et du parfum de son haleine. Je reçus l’ordre de monter, de le réveiller et de lui demander d’avoir la bonté de m’administrer cinquante coups de fouet énergiques. Se faire fouetter est déjà pénible ; devoir le demander est pire ; devoir le demander à un ivrogne est vraiment trop insupportable. J’aurais préféré me précipiter dans un nid de serpents à sonnettes qu’aller vers le lit de cet ivrogne. Mais je fus obligé. Je m’approchai en silence et lui dis d’une voix tremblante en lui secouant doucement le bras : « Maître, maître, maîtresse veut que vous vous réveilliez. » Ce n’était pas ce qu’elle avait ordonné et elle s’écria furieuse : « Quoi ? Tu ne lui demandes pas de te fouetter ? » J’ajoutai donc : « Maîtresse veut que vous me donniez cinquante coups de fouet. » Un ours alléché par l’odeur d’un agnelet n’aurait pas bondi plus vite. « Oui, oui, certainement ; je te fouetterai jusqu’à t’en faire passer l’envie. » Et c’est ce qu’il fit. Il s’élança hors de son lit, me saisit par les cheveux, me fouetta avec une poignée de verges, me précipita au sol, me roua de coups de pied et de poing, me gifla plus violemment qu’un chien, puis me jeta de toutes ses forces hors de sa chambre, plus mort que vif. Je demeurai longtemps étendu, ayant à peine la force ou l’audace de remuer, et quand les furies se furent tues je rampai jusqu’à ma couche, en souhaitant que la mort mette un terme à mes malheurs. Je n’avais aucun ami au monde à qui faire entendre un mot de plainte ni vers qui me tourner pour qu’il me protège.
M. Banton possédait une boutique de forgeron où il passait une partie de la journée, bien qu’il ne fût guère efficace dans la forge. Un jour, maîtresse m’ordonna d’aller à la boutique pour être fouetté par le maître. Je connaissais trop bien la sorte de punition qu’on y pratiquait. Je préférais mourir que d’y aller. Le pauvre bougre qui travaillait à la forge, un ouvrier très adroit, avait une fois oublié de verser le demi-dollar qu’il avait reçu d’un client en paiement d’un travail. C’était un crime impardonnable. Les propriétaires d’esclaves ne veillent plus jalousement sur aucun droit que sur celui de s’approprier le moindre cent gagné par leurs esclaves. Cela parvint à l’oreille du maître. Il réclama l’argent, qui n’avait pas été dépensé ; on le lui donna, mais cela n’effaçait pas l’horrible intention de le garder. Furieux, le maître jeta une poignée de clous dans le feu et, quand ils furent rougis par la chaleur, il les retira et les fit refroidir les uns après les autres dans la chair et le sang du dos de son pauvre esclave. Je savais que c’était le mode de punition de la boutique ; je refusai d’y aller et, quand M. Banton rentra, son aimable épouse lui raconta l’histoire de mon refus ; il s’emporta et me frappa sans pitié, en ajoutant que si j’étais venu, il m’aurait enfoncé des clous incandescents dans le dos. »
Lewis Garrard Clarke, Narrative of the Sufferings of Lewis Clarke, During a Captivity of More than Twenty-Five Years, Among the Algerines of Kentucky, One of the So Called Christian States of North America, Boston, David H. Ela, 1845, p. 16-20. Trad. française Hélène Tronc. Tous droits réservés.
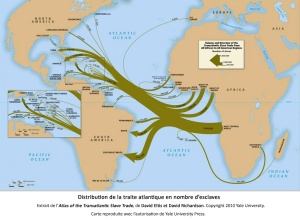
Commentaires fermés