Moses Grandy : Dispersion d’une famille
« Parmi mes enfants, six autres, trois garçons et trois filles, ont été vendus à La Nouvelle-Orléans. Deux des filles ont pu acheter leur liberté. L’aînée, Catherine, a été vendue trois fois depuis qu’elle a quitté la Virginie. La première, aux enchères. Son avant-dernier maître était un Français : elle travaillait dans ses champs de canne à sucre et de coton. Un second Français cherchait une femme de confiance, pour veiller sur son épouse phtisique. Le premier lui proposa ma fille ; ils allèrent la voir dans les champs et l’affaire fut conclue. Son nouveau maître en fit don à son épouse malade et ma fille veilla sur elle jusqu’à sa mort. Comme elle s’était parfaitement occupée de sa femme, le maître lui offrit une chance d’acheter sa liberté. Elle refusa d’abord les conditions de son offre : il exigeait 4 dollars par semaine, pris sur ses gains, et 1200 dollars pour l’affranchir. Il argua qu’il pouvait obtenir davantage en la vendant et qu’elle trouverait sans peine à laver du linge pour un dollar la douzaine de pièces. Elle finit par consentir. Elle habitait près du fleuve et le travail ne manquait pas. Elle était tellement désireuse d’obtenir sa liberté qu’elle travaillait presque tout le temps, de jour comme de nuit, et même le dimanche. Elle trouva cependant qu’elle ne gagnait rien en travaillant le dimanche et arrêta. Elle versait ponctuellement à son maître ses gains hebdomadaires et des acomptes en vue de son émancipation, pour lesquels il signait des reçus. Un vapeur du Mississippi cherchait un bon steward. Elle fut engagée à trente dollars par mois, le salaire habituel ; elle avait aussi le droit de vendre des pommes et des oranges à bord ; et les passagers donnent d’ordinaire un pourboire de vingt-cinq cents à un dollar si l’on s’occupe bien d’eux. Ses gains totaux, incluant le salaire et l’appoint, se montaient à soixante dollars par mois. Elle conserva cet emploi jusqu’à ce qu’elle eût entièrement payé les 1200 dollars pour son affranchissement.
Dès qu’elle reçut les papiers certifiant qu’elle était libre, elle quitta le vapeur, en pensant qu’elle pourrait retrouver sa sœur Charlotte. Ses deux premières tentatives furent infructueuses mais, à la troisième, elle la découvrit travaillant dans un champ de canne à sucre. Elle montra au maître de sa sœur les papiers attestant sa liberté et lui expliqua comment elle l’avait achetée. Il affirma en retour que si sa sœur acceptait de lui verser la même somme, il la laisserait partir. Elles acceptèrent et il fournit un laissez-passer à son esclave. Les deux sœurs s’embarquèrent sur un vapeur et travaillèrent ensemble pour un salaire unique, jusqu’à ce qu’elles aient mis de côté les 1200 dollars nécessaires pour acheter la liberté de la seconde. Le mari de Charlotte est mort ; ses enfants sont restés dans les champs de coton et de canne à sucre ; leur maître refuse de les céder à moins de 2400 dollars. Voici leur nom et leur âge : Zeno, environ quinze ans ; Antoinette, environ treize ans ; Joseph, environ onze ans ; et Josephine, environ dix ans.
Quant à mes autres enfants, je sais seulement qu’une fille prénommée Betsy se trouve non loin de Norfolk en Virginie. Son maître, M. William Dixon, est prêt à la céder pour 500 dollars.
J’ignore où sont mes quatre autres enfants, et s’ils sont morts ou vivants. Il sera très difficile de les retrouver car le nom des esclaves change d’ordinaire avec chaque nouveau maître : ils ont coutume de porter le nom de celui auquel ils appartiennent. Ils n’ont pas de nom de famille propre qui permette de retrouver leur trace. Pour cette raison et parce qu’ils ne savent ni lire ni écrire, puisque la loi les en empêche, lorsque les enfants sont séparés de leurs parents très jeunes, leur trace disparaît après quelques années. Une mère dont l’enfant est vendu et emmené loin sent qu’elle est séparée de lui pour toujours : elle a très peu de chances de savoir ce qui adviendra de lui, en bien ou en mal. Le seul moyen de retrouver un ami ou un parent vendu depuis quelque temps est de suivre sa trace, quand c’est possible, de maître en maître ; ou, à défaut, de se renseigner dans le voisinage pour découvrir où il pourrait être, jusqu’à tomber sur quelqu’un qui sait que telle personne appartenait à tel ou tel maître ; et la personne censée être recherchée se rappellera peut-être le nom de ceux qui possédaient son père et sa mère. L’apparence physique n’apporte guère d’indications car il peut s’être écoulé tant d’années qu’elle s’est effacée de la mémoire des parents ou des amis les plus proches. Il n’existe donc pas de liens durables qui préservent les relations, même les plus étroites, et cela ne fait que renforcer l’affliction des esclaves lorsqu’ils sont vendus et dispersés. J’ai peu d’espoir de retrouver mes quatre enfants. »
Moses Grandy, Narrative of the Life of Moses Grandy, Late a Slave in the United States of America, Londres, Gilpin, 1843, p. 46-50. Trad. française Hélène Tronc. Tous droits réservés.
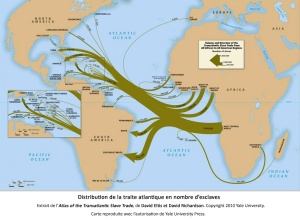
Commentaires fermés