Josiah Henson : Fuite en famille
« Je n’ai élaboré un plan de fuite qu’après avoir longuement réfléchi ; lorsque je fus vraiment décidé, je fis part de mes intentions à ma femme, qui, d’abord trop terrifiée par les dangers d’une telle entreprise, s’efforça de me dissuader en me conjurant d’accepter ma condition. Je lui expliquai, en vain, le risque que nous courions d’être séparés de nos enfants ou l’un de l’autre ; je lui présentai toutes les raisons qui avaient pesé sur mon choix et fini par me décider. Elle n’avait pas subi les mêmes épreuves que moi et sa timidité féminine l’emportait sur le sentiment des maux qu’elle avait endurés. Je retournai la question avec elle plusieurs fois et compris que le raisonnement ne suffirait pas. Je lui affirmai alors, tout à fait délibérément, que même s’il m’était cruel de me séparer d’elle, j’étais prêt à le faire et que j’emmènerais avec moi tous nos enfants hormis le cadet, pour ne pas être séparé d’eux de force et risquer de subir une captivité bien plus pénible, ce à quoi nous étions exposés en permanence. Elle sanglota et m’implora mais me trouva résolu et, après une nuit de discussion, je partis travailler. J’entendis aussitôt sa voix qui m’appelait. J’attendis qu’elle soit à ma hauteur ; me trouvant plus déterminé que jamais, elle me dit enfin qu’elle viendrait avec moi. Ce fut un immense soulagement pour mes nerfs et mes larmes jaillirent aussi vivement que les siennes quelques instants auparavant. Je partis le cœur beaucoup plus léger.
Elle vivait à cette époque près de l’embarcadère que j’ai mentionné. La plantation s’étendait sur les cinq miles séparant la maison du fleuve et comprenait plusieurs fermes que je devais surveiller, en chevauchant de l’une à l’autre chaque jour. Notre fils aîné se trouvait dans la maison de M. Amos, les autres enfants avec ma femme. Elle me donna son accord un jeudi matin et je fixai le départ à la nuit du samedi suivant car on ne découvrirait mon absence qu’après plusieurs jours et je serais déjà loin. Peu avant, j’avais demandé à ma femme de me confectionner un grand sac à dos, assez profond pour contenir les deux cadets ; j’avais prévu qu’elle guiderait notre deuxième enfant, tandis que l’aîné était assez robuste pour marcher seul et m’aider à porter les provisions nécessaires. Le soir, après ma journée de travail, je mettais les deux petits dans le sac à dos et trottais dans la cabane et les parages pour m’habituer et les habituer à l’épreuve qui nous attendait.
La nuit décisive vint enfin. Je me rendis à la grande maison et demandai la permission d’emmener Tom, pour faire repriser ses habits. Il n’y eut pas d’objection et je souhaitai bonne nuit à M. Amos pour la dernière fois. C’était vers la mi-septembre ; à neuf heures du soir tout était prêt. La nuit était noire, sans lune ; nous montâmes dans la petite barque sur laquelle j’avais convaincu un compagnon d’esclavage de nous faire traverser. L’heure était grave et tendue. Le brave homme qui ramait dit que l’affaire se terminerait peut-être par sa mort ; « Mais, demanda-t-il, vous ne serez pas ramenés vivants, n’est-ce pas ? – Certainement pas ! répondis-je. – Et si vous échouez et qu’on vous ramène, vous tairez ma participation ? – Oui, avec l’aide de Dieu. – Alors, je suis tranquille, et je vous souhaite de réussir. » Nous abordâmes sur la berge de l’Indiana ; je commençais à me sentir mon propre maître. Mais dans quel état de peur et de misère ! Nous devions voyager la nuit et nous reposer le jour, dans les bois et les buissons. Nous ne dépendions plus que de nos maigres ressources et ne pouvions compter que sur nos propres forces. La population n’était pas aussi nombreuse qu’aujourd’hui ni aussi bien disposée envers les esclaves. Nous n’osions demander de l’aide à personne. Mais mon courage était à la hauteur des circonstances et nous cheminâmes prudemment mais d’un pas ferme, aussi vite que l’obscurité et la faiblesse de ma femme et de mes garçons le permettaient.
Il nous fallut presque deux semaines pour gagner Cincinnati ; un ou deux jours avant d’arriver, nos provisions étaient épuisées et j’eus la douleur d’entendre les cris affamés et exténués de ceux que j’aimais si chèrement. Il fallait courir le risque de se montrer sur la route en plein jour ; au matin, je m’élançai hors de notre cachette, armé de courage, et me dirigeai vers le sud, pour éviter qu’on me soupçonne d’aller dans l’autre direction. Je m’approchai de la première habitation et demandai si l’on me vendrait un peu de pain et de viande. Non, on n’avait rien pour les personnes noires. J’eus plus de réussite à la maison suivante mais je dus négocier âprement et sans grand succès avec un homme qui voulait m’en donner le moins possible pour mon quart de dollar. L’achat terminé, je repris la route, toujours en direction du sud, et quand il fut impossible de me voir depuis la maison, je m’élançai de nouveau dans les bois et remontai vers le nord, en restant à couvert. La nourriture que j’avais achetée, aussi insuffisante fût-elle, redonna vie à ma femme et à mes enfants et nous finîmes par atteindre Cincinnati sains et saufs. Nous y fûmes gentiment accueillis et reçus plusieurs jours ; ma femme et les cadets reprirent des forces et nous parcourûmes les trente miles suivants dans un chariot.
Notre parti demeura le même qu’auparavant, voyager de nuit et nous reposer le jour, jusqu’à l’arrivée à Scioto, où l’on nous avait dit que nous rencontrerions la route militaire du général Hull, tracée du temps de la dernière guerre contre la Grande-Bretagne, après quoi nous pourrions cheminer de jour en toute sécurité. La route était bien là, conformément aux indications, près du grand sycomore et de l’orme qui en marquaient le début, et nous l’empruntâmes de bonne heure, le moral retrouvé. Personne ne nous avait avertis qu’elle traversait des étendues sauvages et je n’avais pas veillé à emporter des vivres, pensant vite atteindre une habitation où il serait possible d’en obtenir sans danger. Mais nous marchâmes toute la journée sans en apercevoir une et, la nuit venue, nous nous étendîmes le ventre vide et le corps épuisé. Je crus soudain entendre le hurlement des loups et la terreur qui me saisit ainsi que les efforts déployés pour les tenir à distance en faisant du vacarme nous empêchèrent de dormir jusqu’au lever du jour et nous retardèrent, inévitablement. Au matin, nous étions plus affamés que jamais mais il ne restait qu’un petit morceau de bœuf séché pour soulager notre appétit. J’en distribuai un peu à chacun et nous repartîmes pour une deuxième journée de marche à travers une nature sauvage. C’était une épreuve pénible et ce jour est l’un des plus mémorables de ma vie. Le chemin était ardu, il va sans dire, car il n’était guère entretenu et sans cesse obstrué de troncs d’arbres ; le sous-bois était en partie dégagé mais c’est à peu près tout ce qui signalait le chemin. Nous progressions, à bout de forces, et j’avais une petite avance sur ma femme et les garçons quand je les entendis soudain m’appeler ; en me retournant, je vis que ma femme avait trébuché sur une branche et gisait à terre. « Maman va mourir », s’écria Tom ; c’est ce que je crus en arrivant près d’elle. Elle s’était évanouie. Son état pouvait être fatal et la peur et l’incertitude me rendirent à moitié fou. Après quelques minutes, cependant, elle se remit suffisamment pour avaler un peu de viande et un bref repos la raviva tant qu’elle reprit bravement la route, une fois de plus.
Nous n’avions guère progressé et il devait être environ trois heures de l’après-midi lorsque nous aperçûmes, à une faible distance, des gens qui venaient vers nous. Cela nous mit aussitôt sur nos gardes car nous ne pouvions supposer qu’ils fussent des amis. En avançant de quelques pas, je vis que c’étaient des Indiens chargés de ballots et tellement proches que, s’ils étaient hostiles, il était inutile d’essayer de fuir. Je poursuivis donc mon chemin avec aplomb, jusqu’à me trouver très près d’eux. Courbés sous leurs fardeaux, ils n’avaient pas encore levé les yeux ; quand ils me virent approcher, ils me regardèrent un instant apeurés puis, émettant un hurlement étrange, ils firent demi-tour et prirent leurs jambes à leur cou. Ils étaient trois ou quatre et je ne comprenais pas ce qui les effrayait tant, à moins qu’ils n’aient cru que j’étais le diable : ils avaient peut-être entendu dire qu’il était noir. On aurait pu imaginer que la vue de ma femme et de mes enfants les aurait rassurés. Il ne faisait pourtant aucun doute qu’ils avaient très peur et nous entendîmes un long hurlement sauvage accompagner leur course pendant au moins un mile. Ma femme n’était pas moins effrayée car elle pensait qu’ils rentraient en courant rassembler des renforts pour revenir nous tuer ; elle voulait faire demi-tour. Je lui fis valoir qu’ils étaient assez nombreux pour nous tuer sans assistance, s’ils le souhaitaient ; quant à rebrousser chemin, le trajet parcouru avait été bien assez pénible et il aurait été ridicule que les deux côtés prennent la fuite. S’ils préféraient courir, je les suivrais. Nous continuâmes notre route et le bruit cessa bientôt ; à mesure que nous avancions, nous apercevions des Indiens qui nous observaient, cachés derrière les arbres, et qui disparaissaient sitôt qu’ils pensaient être regardés. Nous arrivâmes à leurs wigwams où un Indien majestueux et de belle apparence nous attendait, les bras croisés. C’était visiblement leur chef ; il nous salua avec civilité et comprit que nous étions des êtres humains ; il s’adressa aux jeunes gens éparpillés et leur demanda d’approcher et d’abandonner leurs craintes insensées. La curiosité semblait maintenant l’emporter. Chacun voulait toucher les enfants, devenus aussi timides que des perdrix après tout le temps passé dans les bois ; quand ils reculaient et poussaient un petit cri d’alarme, les Indiens reculaient aussi, comme si les enfants allaient les mordre. Ils comprirent cependant vite qui nous étions, où nous allions et ce dont nous avions besoin ; ils entreprirent aussitôt de satisfaire nos désirs, nous offrirent une nourriture copieuse et nous donnèrent un wigwam où passer la nuit. Le lendemain, nous poursuivîmes notre marche, ayant appris des Indiens que nous n’étions qu’à vingt-cinq miles du lac. Ils envoyèrent quelques jeunes gens nous indiquer où il fallait obliquer et prirent congé avec toute la gentillesse imaginable.
En parcourant l’immense plaine de l’Ohio qui borde le lac, nous arrivâmes à un endroit où la route était submergée par un cours d’eau. Je la sondai d’abord avec une perche, puis je pris les enfants sur mon dos, un par un, en commençant par les deux plus petits, et enfin ma femme. Je réussi à les faire tous passer de l’autre côté sains et saufs, là où le gué faisait cent à cent cinquante yards de large et où la profondeur atteignait peut-être quatre pieds. Mon dos était à vif sur une surface presque égale à la taille de mon sac à dos.
Après une nouvelle nuit dans les bois, nous débouchâmes, l’après-midi suivant, sur la vaste plaine dénudée qui s’étend au sud et à l’ouest de la ville de Sandusky. Nous apercevions les maisons du village mais nous restâmes à l’écart tant que je n’avais pas été en reconnaissance. À environ un mile du lac, je cachai mes compagnons dans les buissons et continuai d’avancer. Peu après, je découvris sur la gauche, du côté opposé à la ville, un bâtiment qui ressemblait à une maison, et plusieurs hommes qui s’activaient entre cette maison et un bateau. Je décidai promptement de les aborder ; l’un des hommes me héla et demanda si je cherchais du travail. Je fis signe que oui et, moins d’une minute plus tard, j’étais chargé d’un sac de maïs que je devais, comme tous les autres, vider dans la cale du navire amarré non loin de là. Je pris place dans la file des travailleurs, me hâtant sur la passerelle à côté du seul homme de couleur que je voyais au travail ; j’entrepris aussitôt de discuter avec lui, pour savoir où ils allaient, quel était le meilleur chemin pour se rendre au Canada, qui était le capitaine, et d’autres détails qui m’intéressaient, et je lui appris d’où je venais et où je voulais aller. Il en informa le capitaine qui me prit à l’écart et qui, par son air et ses manières franches, me convainquit bientôt de reconnaître ma condition et mes intentions. Je ne m’étais pas trompé sur son compte. Il sympathisa aussitôt avec moi, très chaleureusement ; il proposa de m’emmener avec ma famille à Buffalo, où ils devaient se rendre et où ils arriveraient peut-être le lendemain soir, si le vent demeurait favorable ; ils se hâtaient pour en profiter. Jamais hommes ne travaillèrent avec autant d’ardeur et on eut vite transporté deux ou trois cents boisseaux à bord ; on ferma les écoutilles, on leva l’ancre et hissa les voiles. Le capitaine avait convenu de m’envoyer une barque après le coucher du soleil, au lieu de me faire monter à bord depuis l’embarcadère : des espions du Kentucky guettaient les esclaves à Sandusky et ils risquaient de me repérer si je faisais sortir mon petit groupe du bois en plein jour. Lorsque le bateau leva les amarres, je le suivis du regard avec une attention intense, tout en commençant à redouter qu’il ne parte finalement sans moi ; il vogua très loin, me sembla-t-il, avant de faire demi-tour. Mais il finit par remonter le courant et par envoyer une barque en direction de la rive ; quelques minutes plus tard, mon ami noir et deux marins débarquaient sur la grève. Nous partîmes aussitôt chercher ma femme et mes enfants. Mais quelle ne fut pas mon inquiétude lorsque, arrivé à l’endroit où je les avais laissés, je découvris qu’ils avaient disparu ! Mes craintes l’emportèrent un instant mais je finis par les apercevoir non loin de là, dans la lumière déclinante du crépuscule. Effrayée par ma longue absence, ma femme avait pensé que des ennemis aux aguets m’avaient surpris et que tout était perdu. Ses craintes ne s’étaient pas dissipées lorsqu’elle m’avait vu revenir avec trois hommes et elle avait essayé de se cacher. Je réussis à grand peine à la convaincre que tout allait bien, car elle était si agitée qu’elle ne put comprendre tout d’abord ce que je lui disais. L’incident fut bientôt clos et la gentillesse de mes compagnons y contribua grandement. Nous nous dirigeâmes sans tarder vers le bateau ; il fallut très peu d’efforts pour embarquer nos bagages. Nous arrivâmes au navire en quelques coups de rame et, à mon grand étonnement, nous fûmes accueillis à bord par trois joyeux hourras ; l’équipage se réjouissait autant que le capitaine de l’aide qu’il nous apportait dans notre fuite. Nous atteignîmes Buffalo sans encombre le lendemain soir mais il était trop tard pour traverser le fleuve cette nuit-là. Le lendemain matin, nous relâchâmes à Black Rock et le bon capitaine Burnham, dont je me souviens avec gratitude, nous mit sur le bac pour Waterloo, paya notre passage et me donna un dollar en nous quittant. Cet Écossais a fait assez pour mériter ma reconnaissance éternelle, pour prouver qu’il est un homme bon et généreux et pour que je garde une image favorable de son dialecte et de son pays.
En arrivant du côté canadien, le matin du 28 octobre 1830, mon premier geste fut de me jeter au sol et, donnant libre cours à la frénésie exubérante de mes sentiments, de faire toutes sortes de cabrioles, qui suscitèrent l’étonnement des passants. Un monsieur du voisinage, le colonel Warren, pensa que j’avais un accès et comme il s’enquerrait de l’état de ce pauvre bougre, je fis un bond et lui dis que j’étais libre. « Oh, dit-il en riant de bon cœur, c’est donc cela ? Je n’avais encore jamais vu un homme se rouler dans le sable au nom de la liberté. »
Josiah Henson, The Life of Josiah Henson, Formerly a Slave, Now an Inhabitant of Canada, as Narrated by Himself, Boston, A. D. Phelps, 1849, p. 48-59. Trad. française Hélène Tronc. Tous droits réservés.
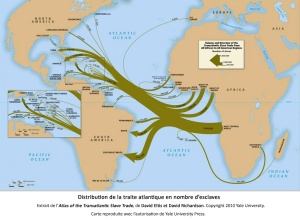
Commentaires fermés