Solomon Northup : Le travail sur une plantation de coton
« La saison de la récolte du coton commence à la fin du mois d’août. Chaque esclave reçoit un sac muni d’une sangle qu’il passe autour de son cou, de sorte que l’ouverture du sac lui arrive à la poitrine, tandis que le fond touche presque terre. Chacun reçoit aussi un grand panier d’une capacité d’environ deux barils où il déverse le coton quand le sac est plein. Les paniers sont emportés dans les champs et placés au début de chaque rangée.
La première fois qu’un nouvel esclave inexpérimenté est envoyé dans les champs, il est fouetté sans relâche et pressé de travailler le plus vite possible. Le soir, on pèse sa récolte pour connaître sa capacité de cueillette. Il devra rapporter le même poids de coton toutes les nuits. S’il y manque, on considère que c’est la preuve qu’il a traîné et il reçoit un nombre variable de coups de fouet en guise de punition.
Une journée ordinaire de travail permet de récolter deux cents livres de coton. Les esclaves, hommes et femmes, habitués à la cueillette sont punis s’ils n’atteignent pas ce poids. Il existe de grandes disparités dans ce genre de tâche. Certains semblent posséder un don naturel, une rapidité qui leur permet de cueillir vite et des deux mains, tandis que d’autres, malgré une longue pratique et beaucoup d’efforts, sont totalement incapables d’atteindre le poids moyen. Ces esclaves sont retirés des champs de coton et employés à d’autres travaux. Patsey, dont je reparlerai, avait la réputation d’être la meilleure cueilleuse de coton à Bayou Bœuf. Elle cueillait des deux mains et à une vitesse si stupéfiante qu’il n’était pas rare qu’elle récoltât cinq cents livres en une journée.
Chacun se voit donc assigner une tâche en fonction de ses capacités mais personne ne doit récolter moins de deux cents livres. Moi qui ai toujours été très maladroit dans cet exercice, j’aurais contenté mon maître si je lui avais rapporté cette quantité de coton, tandis que Patsey aurait sûrement été battue si elle avait échoué à en cueillir le double.
Les cotonniers atteignent cinq à sept pieds de haut ; chacun a de nombreuses branches qui poussent en tous sens et s’entremêlent au-dessus du sillon d’irrigation.
Rares sont les spectacles aussi plaisants que celui d’un vaste champ de coton en fleurs. Il s’en dégage une impression de pureté, comme d’une immense étendue de lumière immaculée ou de neige fraîchement tombée.
Les esclaves cueillent parfois un côté d’une rangée avant de remonter de l’autre mais, le plus souvent, ils travaillent par paire, de part et d’autre d’une rangée, et cueillent toutes les fleurs en laissant les capsules encore fermées pour un passage ultérieur. Lorsque leur sac est plein, ils le vident dans le panier et tassent le coton en le piétinant. La première fois qu’on traverse un champ il faut faire très attention à ne pas casser les branches des cotonniers car une branche cassée ne fleurit pas. Epps ne manquait jamais d’infliger le châtiment le plus sévère au malheureux qui, par manque de vigilance ou parce qu’il n’avait pu faire autrement, était coupable de cette faute.
Les esclaves doivent se trouver dans les champs de coton dès l’aube et, à l’exception des dix ou quinze minutes qui leur sont accordées à midi pour avaler leur ration de lard froid, ils n’ont pas le droit de s’arrêter un seul instant avant qu’il fasse trop sombre pour y voir. Durant la pleine lune, il n’est pas rare qu’ils travaillent jusqu’au milieu de la nuit. Ils n’osent pas s’arrêter à l’heure du dîner ni retourner dans leurs quartiers, aussi tard soit-il, tant que le surveillant n’a pas donné l’ordre de cesser le travail.
Lorsque la journée est terminée dans les champs, les paniers sont « totalisés », c’est à dire transportés à l’égreneuse, pour la pesée. Même l’esclave le plus las et le plus exténué, même celui qui ne pense qu’à dormir et à se reposer ne s’avance jamais vers l’égreneuse avec son panier de coton sans être terrassé par la peur. S’il n’a pas cueilli le poids requis, s’il n’a pas accompli la tâche qui lui était assignée, il sait qu’il va souffrir. Et s’il a dépassé le poids de dix ou vingt livres, son maître réajustera vraisemblablement la tâche du lendemain en conséquence. Qu’il ait donc récolté trop ou trop peu de coton, il s’approche toujours de l’égreneuse avec effroi et en tremblant. Le plus souvent, la cueillette est insuffisante et les esclaves n’ont pas envie de quitter les champs. À la pesée succèdent les coups de fouet. On transporte ensuite les paniers jusqu’au hangar à coton et leur contenu est mis à l’abri, comme le foin. Tous les ouvriers doivent piétiner le coton pour le tasser. S’il n’est pas sec, au lieu de l’emporter aussitôt à l’égreneuse, on l’étale sur des claies de deux pieds de haut et de six de large, couvertes de planches et séparées par d’étroites allées.
La journée de travail est encore loin d’être terminée. Chacun doit vaquer à ses tâches respectives. L’un nourrit les mules, un autre le cochon, un troisième coupe du bois, et ainsi de suite ; la mise en balles se fait entièrement à la lueur des bougies. Ce n’est qu’à une heure très avancée de la nuit que les esclaves regagnent leurs quartiers, abattus et harassés par leur longue journée de labeur. Il leur faut encore allumer un feu dans leur cabane, moudre le maïs dans un petit moulin à bras et préparer le dîner et le déjeuner du lendemain. Ils n’ont droit qu’à du maïs et à du lard, distribués au séchoir à maïs et au fumoir tous les dimanches matins. Chacun reçoit comme ration hebdomadaire trois livres et demie de lard et assez de maïs pour obtenir un picotin de farine. Rien d’autre : ni thé, ni café, ni sucre et, à l’exception d’une petite pincée de temps à autre, pas de sel. Après dix années passées chez M. Epps, je peux assurer qu’aucun de ses esclaves ne risque de succomber à la goûte, causée par une vie d’excès. M. Epps nourrissait ses porcs au maïs égrené tout en faisant jeter à ses « nègres » du maïs en épi. Il pensait que les premiers engraisseraient plus vite si le maïs était égrené et imbibé d’eau, tandis que les seconds risquaient de devenir trop gros pour travailler s’ils recevaient la même nourriture. M. Epps était très calculateur et, ivre comme à jeun, il savait s’occuper de ses bêtes.
Le moulin à maïs se trouve dans la cour, sous un abri. Il ressemble à un moulin à café ordinaire avec une trémie d’environ six litres. M. Epps accordait un privilège à tous ses esclaves : ils avaient le droit de moudre leur maïs la nuit, pour satisfaire leurs besoins journaliers, ou de moudre leur ration hebdomadaire en une seule fois, le dimanche, selon leur préférence. Un homme vraiment généreux ce M. Epps !
Je conservais mon maïs dans une petite boîte en bois et ma farine dans une calebasse ; celle-ci est d’ailleurs l’un des ustensiles les plus précieux sur une plantation. Elle remplace toutes sortes d’instruments dans une cabane et permet aussi d’emporter de l’eau aux champs. Une autre calebasse contiendra le repas de midi. Inutile de posséder seaux, louches, bassines et autres ustensiles de bois ou de métal finalement superflus.
Lorsqu’il a moulu son maïs et allumé le feu, l’esclave retire le lard du clou où il pend, en coupe une tranche et la jette sur les braises pour la faire griller. La plupart n’ont pas de couteau, encore moins de fourchette. Ils tranchent le lard avec la hache du tas de bois. Ils diluent la farine de maïs dans un peu d’eau et mettent cette galette à cuire dans le feu. Lorsqu’elle a bruni, ils grattent les cendres et la posent sur une planchette qui leur tient lieu de table. L’occupant de la hutte peut alors prendre place par terre pour manger son repas. Il est en général minuit. Et la peur du châtiment qui habite les esclaves devant l’égreneuse de coton les saisit de nouveau lorsqu’ils s’allongent pour prendre un peu de repos. Ils craignent de ne pas se réveiller à temps le lendemain matin. Un tel crime ne mérite pas moins de vingt coups de fouet. C’est en priant pour être debout et bien éveillé dès le premier son de la trompe que l’esclave s’enfonce dans le sommeil chaque nuit.
Les couches les plus moelleuses au monde sont inconnues dans les cabanes en bois des esclaves. Celle sur laquelle je m’allongeais jour après jour mesurait douze pouces de large sur dix pieds de long. Mon oreiller était un rondin. La literie, une couverture grossière, sans autre guenille ni chiffon. On aurait pu employer de la mousse mais elle est vite infestée de puces.
La cabane est construite en rondins, sans plancher ni fenêtres. Celles-ci sont d’ailleurs inutiles car les espaces entre les rondins laissent passer suffisamment de lumière. En cas d’orage, la pluie pénètre à l’intérieur, rendant la cabane inconfortable et désagréable. La porte rudimentaire repose sur de grandes charnières en bois. Une cheminée malcommode occupe une extrémité de la pièce.
Une heure avant l’aube, la trompe sonne. Les esclaves se lèvent, préparent leur petit-déjeuner, remplissent une calebasse d’eau, une autre de leur repas froid composé de lard et de pain de maïs, et se hâtent de nouveau vers les champs. C’est un crime invariablement puni d’une séance de fouet d’être trouvé dans les quartiers des esclaves après le lever du jour. Les peurs et les peines d’une nouvelle journée commencent ; avant qu’elle ne se termine, pas le moindre repos. Peur d’être surpris à traîner durant la journée ; peur de se rendre, la nuit, à l’égreneuse avec le panier de coton ; peur, en s’endormant, de ne pas se réveiller à temps le lendemain. Voilà une description vraie, fidèle et sans exagération de la vie quotidienne des esclaves pendant la saison de la cueillette du coton, sur les rives de Bayou Bœuf.
En janvier, on procède en général à la quatrième et dernière cueillette. Puis commence la récolte du maïs. Celui-ci est considéré comme une culture secondaire et requiert beaucoup moins de soin que le coton. Comme je l’ai déjà mentionné, on le plante en février. Dans cette région, on le cultive pour engraisser les porcs et nourrir les esclaves ; on en vend très peu, voire pas du tout, sur les marchés. Il s’agit de la variété blanche à très grands épis, qui peut atteindre huit et même souvent dix pieds. En août, on effeuille le maïs, on fait sécher les feuilles au soleil puis on les lie en petites gerbes qu’on met de côté comme fourrage pour les mules et les bœufs. Les esclaves parcourent ensuite les champs et retournent les épis afin d’empêcher la pluie de pénétrer jusqu’aux grains. On laisse le maïs ainsi jusqu’à la fin de la récolte du coton, qu’elle soit tardive ou précoce. On sépare ensuite les épis de la tige et on les place dans le séchoir avec leur enveloppe qui les protège du charançon. On laisse les tiges debout dans les champs.
Dans cette région, on cultive aussi, mais dans une moindre mesure, la caroline ou patate douce. Elle ne sert toutefois pas à nourrir les cochons ou le bétail et on ne la considère que de peu d’importance. Elle est conservée à même le sol, recouverte d’une fine couche de terre ou de tiges de maïs. Il n’existe pas de caves à Bayou Bœuf. Le sol est tellement bas qu’elles se rempliraient d’eau. Les patates se vendent deux ou trois pièces ou shillings le baril ; sauf en cas de pénurie, on trouve du maïs au même prix.
Dès que les récoltes de coton et de maïs sont à l’abri, on arrache les tiges de maïs, on les entasse et on les brûle. Le labourage commence aussitôt et on retourne la terre pour préparer les nouvelles plantations. Dans les paroisses de Rapides et d’Avoyelles, et dans toute la région, d’après mes observations, la terre est excessivement riche et fertile. C’est une sorte de marne brune ou rougeâtre. Elle n’a pas besoin des composts fertilisants nécessaires aux sols plus pauvres et un champ peut recevoir la même culture de nombreuses années de suite.
Le labour, les plantations, la cueillette du coton, la récolte du maïs, l’arrachage et le brûlage des tiges occupent les quatre saisons de l’année. L’extraction et la coupe du bois, le tassage du coton, l’engraissement et le dépeçage des cochons ne sont que des tâches secondaires.
En septembre ou en octobre, on débusque les cochons des marais avec des chiens puis on les enferme dans des enclos. Un matin froid, généralement vers le Nouvel An, on les tue. Les carcasses sont découpées en six, salées et empilées les unes sur les autres, sur de grandes tables, dans le fumoir. On les laisse ainsi reposer quinze jours, avant de les suspendre au-dessus d’un feu qu’on alimente plus de la moitié de l’année. Le fumage de la viande doit durer longtemps pour éviter que le lard ne soit infesté de vers. Sa conservation est difficile dans un climat aussi chaud et mes compagnons et moi avons souvent trouvé notre ration hebdomadaire de trois livres et demie pleine de cette vermine dégoûtante.
Les marais sont peuplés de bétail mais celui-ci n’est jamais une vraie source de profit. Le planteur entaille l’oreille de ses bêtes ou marque leur flanc de ses initiales puis les dirige vers les marais, où elles paissent en liberté dans ces espaces presque illimités. C’est une race espagnole, petite, à cornes pointues. Il est arrivé que des troupeaux entiers soient volés à Bayou Bœuf mais c’est très rare. La meilleure vache ne vaut pas plus de cinq dollars. Elles donnent rarement deux litres de lait en une traite. Elles produisent peu de suif, et d’une qualité molle et inférieure. Malgré le grand nombre de vaches qui pullulent dans les marais, les planteurs sont redevables au Nord pour leur fromage et leur beurre, qu’ils achètent au marché de La Nouvelle-Orléans. Le bœuf salé n’est une nourriture répandue ni dans la grande maison ni dans les cabanes des esclaves.
M. Epps avait coutume de se rendre à des parties de chasse pour se procurer le bœuf frais dont il avait besoin. Elles avaient lieu chaque semaine à Holmesville, le village voisin. Les planteurs y tirent au fusil des bœufs bien gras amenés exprès, en payant un forfait pour ce privilège. L’heureux propriétaire des bêtes abattues répartit la chair entre ses compagnons et c’est ainsi que les planteurs présents sont ravitaillés en viande.
C’est très probablement le nombreux bétail domestique ou sauvage peuplant les bois et les marais de Bayou Bœuf qui a suggéré ce nom aux Français, puisqu’il signifie « le ruisseau ou la rivière du bœuf sauvage ».
Les produits du jardin comme les choux et les navets sont cultivés pour la consommation du maître et de sa famille. Ceux-ci mangent des légumes tout au long de l’année, en toute saison. Sous les latitudes glacées du Nord « l’herbe se dessèche et la fleur se fane » sous les vents ravageurs de l’automne, alors que dans la région de Bayou Bœuf les plaines chaudes sont perpétuellement couvertes de verdure et les fleurs s’épanouissent au cœur de l’hiver.
Il n’existe pas de prairies réservées à la culture des foins. Les feuilles de maïs fournissent une nourriture assez abondante pour le bétail qui travaille, tandis que les autres bêtes paissent en liberté toute l’année dans les pâturages verdoyants.
Le climat, les habitudes, les coutumes et les manières de vivre et de travailler dans le Sud ont beaucoup d’autres particularités mais cette description donnera au lecteur, nous l’espérons, un aperçu et une idée générale de la vie sur une plantation de coton en Louisiane. »
Solomon Northup, Twelve Years a Slave: Narrative of Solomon Northup, a Citizen of New-York, Kidnapped in Washington City in 1841, and Rescued in 1853, Auburn (N.Y.), Derby and Miller, 1853, p. 165-175. Trad. fr. Hélène Tronc. Tous droits réservés.
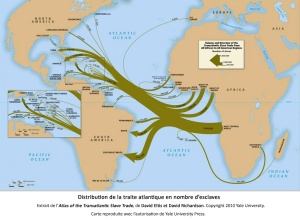
Commentaires fermés