Henry Bibb : A vendre
« En arrivant à Vicksburg, Garrison avait l’intention de vendre une partie de ses esclaves et il s’y arrêta trois semaines à cette fin. Sans grand succès.
Il nous fallut subir un examen, ou une inspection, mené par un agent municipal chargé de contrôler les lots d’esclaves que l’on venait vendre à ce marché. Il observa notre dos pour voir si le fouet nous avait beaucoup marqués. Il examina nos membres, pour évaluer si nous étions de qualité inférieure.
Comme il est difficile de déterminer l’âge d’un esclave, on lui ouvre la bouche pour examiner ses dents et on lui pince le dos de la main ; s’il est très âgé, le pli de peau reste dressé quelques secondes.
Mais de tous les examens auxquels les inspecteurs soumettent les esclaves, le plus rigoureux est celui de leurs capacités mentales. Une grande intelligence est la plus fâcheuse des qualités pour mener la vie d’esclave. Elle met en péril l’assimilation de celui-ci à un bien meuble et favorise ce que les propriétaires aiment appeler l’irrémissible péché car elle pousse les esclaves à fuir au Canada. Les inspecteurs y lisent aussi l’amour de la liberté, le patriotisme, des insurrections, des effusions de sang et une guerre d’extermination contre l’esclavage américain.
Ils veillent donc à s’enquérir si un esclave proposé à la vente sait lire ou écrire. Cette question m’a maintes fois été posée par des propriétaires d’esclaves et des planteurs de coton lorsque j’étais à vendre. Après s’être entretenus avec moi, ils juraient sur le Créateur qu’ils ne me prendraient pas parmi leurs nègres, qu’ils voyaient le diable dans mon regard, que je m’enfuirais, etc.
On me demandait aussi très souvent si j’avais déjà pris la fuite mais Garrison répondait en général à cette question à ma place, par la négative. Il aurait pu vendre ma petite famille pour la somme de mille dollars sans difficulté. Mais, par crainte de ne pouvoir me négocier aussi avantageusement, car les gens n’aimaient pas mon apparence, il préférait nous vendre en un seul lot. Ma femme attirait tous les acheteurs, moi presque aucun. Garrison demandait deux mille cinq cents dollars mais il ne put trouver aucun acquéreur à ce prix.
Il tentait de spéculer sur mon caractère chrétien, faisant valoir que j’étais si pieux et honnête que je ne m’enfuirais pas, même si j’étais maltraité. Il se trompait gravement car de ma vie ma religion n’a été assez forte pour m’empêcher de fuir l’esclavage.
De Vicksburg on nous conduisit à La Nouvelle-Orléans, où nous devions être vendus à tout prix. On nous emmena dans la cour d’un marchand, une prison pour esclaves, au coin de la rue Saint-Joseph. Le lieu était fréquenté par les marchands d’esclaves et les planteurs ; on y confinait toutes sortes d’esclaves destinés à des ventes publiques ou privées : jeunes, vieux, hommes, femmes, enfants, parents, maris, épouses.
Chaque jour à dix heures, on exposait les esclaves mis en vente. Ils devaient soigner leur apparence pour se montrer au public. Chaque tête devait être peignée, chaque visage frotté, et tous ceux qui avaient un aspect sombre ou rugueux étaient contraints de se laver à l’eau de vaisselle grasse pour avoir l’air luisant et animé.
Quand le public entrait dans la cour, on ordonnait aux esclaves de sortir et de se mettre en rang. Ils devaient se tenir droits et paraître alertes ; si on leur posait une question, ils devaient aussitôt répondre et inciter les spectateurs à les acheter. S’ils échouaient, ils étaient sévèrement battus après le départ du public. On utilisait dans ce cas un battoir, au lieu du fouet, pour dissimuler les marques laissées par les coups. Et l’on frappait, dans ces circonstances, pour que les esclaves tiennent à être vendus.
Le battoir est une pièce de bois de hickory épaisse d’un pouce environ, large de trois et longue de dix-huit. La partie que l’on applique sur la chair est perforée de trous d’environ un quart de pouce qui font jaillir le sang ou naître des cloques chaque fois que la chair de la victime est touchée. Ceux que l’on frappe ainsi sont toujours entièrement dévêtus et ont les mains attachées. On les force à se courber en deux, les genoux serrés entre les coudes, puis on passe un bâton entre leurs coudes et la pliure de leurs jambes pour les immobiliser, tandis qu’on frappe avec le battoir les parties du corps les moins susceptibles d’être vues par les acheteurs éventuels.
Je suis resté dans cette geôle plusieurs mois mais personne ne voulait m’acheter de crainte que je m’enfuie. »
Henry Bibb, Narrative of the Life and Adventures of Henry Bibb, an American Slave, Written by Himself, New York, 1849, p. 101-105. Trad. française Hélène Tronc. Tous droits réservés.
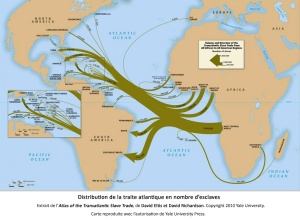
Commentaires fermés