Frederick Douglass : Je n’ai qu’une vie à perdre
« S’il est une période de ma vie, entre toutes, où je fus contraint de boire jusqu’à la lie la coupe amère de l’esclavage, ce fut durant les six premiers mois de mon séjour chez M. Covey. Nous devions travailler par tous les temps. Il ne faisait jamais trop chaud ni trop froid ; il ne pleuvait, ventait, grêlait, neigeait jamais assez pour nous empêcher de travailler dans les champs. Travailler, travailler, travailler était à peine plus l’ordre du jour que de la nuit. Les journées les plus longues étaient trop courtes pour lui et les nuits les plus courtes trop longues. Si j’étais quelque peu indocile à mon arrivée, cette discipline me dompta en quelques mois. M. Covey réussit à me briser. Il brisa mon corps, mon âme et mon esprit. Mon élasticité naturelle fut anéantie, mon intelligence dépérit, mon désir de lire disparut, l’étincelle joyeuse qui habitait mon regard mourut ; la nuit obscure de l’esclavage se referma sur moi ; et voilà un homme transformé en brute !
Le dimanche était mon seul jour de repos. Je le passais dans une sorte de stupeur bestiale, entre sommeil et veille, sous un grand arbre. Je me levais parfois, un éclair de liberté transperçait mon âme de son énergie, accompagné d’une faible lueur d’espoir qui vacillait un moment avant de s’évanouir. Et je retombais, en me lamentant sur ma misérable condition. Je fus parfois tenté de mettre fin à mes jours et à ceux de M. Covey mais un mélange d’espoir et de peur m’en empêcha. Aujourd’hui, mes souffrances sur cette plantation me semblent plus un rêve qu’une dure réalité.
Notre maison était située à quelques encablures de la baie de Chesapeake dont le vaste giron resplendissait des voiles de toutes les parties du monde habité. Ces magnifiques vaisseaux, drapés d’un blanc immaculé, qui ravissaient tellement le regard des hommes libres, étaient pour moi autant de fantômes dans leur suaire, qui me terrifiaient et me tourmentaient en me rappelant ma misérable condition. Souvent, dans le calme profond d’un dimanche d’été, je me suis tenu seul, sur les hautes berges de cette noble baie, le cœur triste et les yeux pleins de larmes, pour suivre les voiles innombrables s’élançant vers le vaste océan. Leur vue m’a toujours profondément ému. Mes pensées devaient s’exprimer ; et là, sans autre témoin que le Tout-Puissant, je laissais s’épancher la plainte de mon âme, à ma façon rustre, en apostrophant la multitude mouvante des navires :
« Vous avez rompu vos amarres, vous êtes libres ; moi je suis enchaîné à mes fers et je suis un esclave ! Vous avancez gaiement sous la brise légère et moi tristement sous le fouet sanglant ! Vous êtes les anges de la liberté qui volez à tire-d’aile autour du monde ; je suis emprisonné dans des anneaux de fer ! Ah ! si j’étais libre ! Ah ! si j’étais sur l’un de vos superbes ponts et sous votre aile protectrice ! Hélas ! Entre vous et moi, roulent les eaux turbides. Partez, partez. Si je pouvais partir aussi ! Si je pouvais seulement nager ! Si je pouvais voler ! Pourquoi suis-je né un homme dont on fait une brute ! L’heureux navire s’en est allé ; il s’estompe dans le lointain brumeux. Je reste seul dans l’enfer brûlant de l’esclavage sans fin. Dieu, sauve-moi ! Dieu, délivre-moi ! Accorde-moi la liberté ! Existe-t-il un Dieu ? Pourquoi suis-je esclave ? Je vais m’enfuir. Je ne le supporterai pas. Que l’on m’attrape ou que je m’échappe, je dois essayer. Autant mourir de la peste que du choléra. Je n’ai qu’une vie à perdre. Autant me faire tuer en courant que mourir immobile. Seulement cent miles droit au nord et je suis libre ! Essayer ? Oui ! Avec l’aide de Dieu, je le ferai. Il est impossible que je vive et meure esclave. Je passerai par les eaux. Cette baie me portera vers la liberté. Les bateaux à vapeur mettaient le cap au nord-est à partir de North Point. Je ferai de même ; et lorsque je parviendrai à l’extrémité de la baie, je laisserai dériver ma barque et je traverserai le Delaware à pied pour atteindre directement la Pennsylvanie. Arrivé là, je n’aurai pas besoin de laissez-passer ; je pourrai voyager sans encombre. Que se présente la première chance et advienne que pourra, je pars. D’ici là, je tâcherai d’endurer le joug. Je ne suis pas le seul esclave au monde. Pourquoi gémir ? Je suis capable d’en supporter autant que tous les autres. Je ne suis qu’un jeune garçon et tous les garçons dépendent de quelqu’un. Ma misère d’esclave ne fera peut-être qu’augmenter mon bonheur d’homme libre. Il viendra des jours meilleurs. »
C’est ainsi que je songeais et que je me parlais à moi-même, exalté jusqu’à la folie un instant pour me réconcilier juste après avec mon misérable sort. »
Frederick Douglass, La vie de Frederick Douglass, esclave américain, écrite par lui-même, tr. fr. Hélène Tronc, Gallimard, coll. « La Bibliothèque », p. 111-113.
Original anglais: Frederick Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. Written by Himself, Boston, Anti-Slavery Office, 1845, p. 63-65.
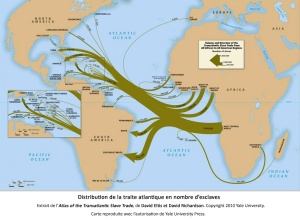
Commentaires fermés