Henry Bibb : Le chemin de fer clandestin
« Le bateau arriva vers neuf heures du matin à Cincinnati et j’attendis que presque tous les passagers aient débarqué ; puis j’entrepris de remonter la rue avec toute la grâce possible, comme si je n’étais pas en fuite, jusqu’à ce que j’aie parcouru une grande partie de Broadway. Je voulais gagner le Canada mais ne connaissant pas le chemin, je devais me renseigner avant de quitter la ville. J’avais peur d’interroger une personne blanche et ne voyais aucune personne de couleur à qui m’adresser. Heureusement pour moi, je tombai sur une bande de petits garçons qui jouaient dans la rue et, en leur posant des questions indirectes, je découvris la maison d’un homme de couleur.
— Les garçons, pouvez-vous me dire où habite ce vieil homme de couleur qui scie du bois et travaille dans les rues ?
— Comment s’appelle-t-il ?, dit l’un des garçons.
— J’ai oublié
— Est-ce que c’est le vieux Job Dundy ?
— Dundy est un homme de couleur ?
— Oui, monsieur.
— C’est l’homme que je cherche ; veux-tu me montrer où il habite ?
— Oui, répondit le petit garçon, et il m’indiqua la maison.
M. D. me fit entrer et je trouvai en lui un véritable ami. Il me demanda si j’étais un esclave du Kentucky et si je comptais redevenir esclave. Ne sachant encore s’il approuvait les évasions d’esclaves, je lui répondis que j’étais venu passer les vacances de Noël et qu’ensuite je rentrerai. Il me dit alors : « Mon fils, je n’y retournerais jamais si j’étais toi ; tu as droit à ta liberté. » Je lui demandai comment l’obtenir. Il me parla du Canada, sur lequel flottait la bannière de la liberté, défendue par le gouvernement britannique, qui refusait d’accepter l’empreinte d’un esclave sur son sol.
Il se mit à me parler des moyens de gagner le Canada, des abolitionnistes et des sociétés abolitionnistes, ainsi que de leur fidélité à la cause de l’humanité qui souffre. C’était la première fois de ma vie que j’entendais parler de leur existence. Je pensais qu’il devait s’agir d’une race différente. Il me conduisit jusqu’à la maison de l’un de ces chaleureux amis de Dieu et des esclaves. Celui-ci était prêt à aider un pauvre fugitif en route vers le Canada, en partageant au besoin son dernier cent ou morceau de pain.
Ces bons amis me donnèrent à manger et me mirent sur le chemin du Canada, en me recommandant de m’arrêter chez une de leurs connaissances. C’était le début de ce qu’on appelait le chemin de fer clandestin vers le Canada. Je m’élançai plein de courage, confiant dans les effets de l’Omnipotence, guidé par l’immuable étoile polaire la nuit, et inspiré par l’idée exaltante que je fuyais une terre d’esclavage et d’oppression, et laissais derrière moi les menottes, les fouets, les écrase-doigts et les chaînes.
Je marchai jusque là où vivait l’abolitionniste que l’on m’avait recommandé mais ne m’arrêtai pas : j’avais trop peur d’être poursuivi par les chiens de chasse esclavagistes du Sud. Je continuai mon chemin énergiquement pendant presque quarante-huit heures sans manger ni me reposer, luttant contre des difficultés extérieures inimaginables pour qui ne les a pas vécues : ne sachant quand je serai capturé lorsque je voyageais parmi des étrangers, dans le froid et la peur, affrontant les vents du nord, vêtu de peu, battu par des tempêtes de neige jusqu’aux heures les plus sombres de la nuit, sans pouvoir me protéger de l’orage en me réfugiant dans une maison.
Deux nuits après avoir quitté Cincinnati, vers minuit, je crus que j’allais mourir de froid ; mes chaussures étaient si usées que mes pieds touchaient le sol. Je m’approchai d’une maison au bord de la route, frappai à la porte et demandai si je pouvais me réchauffer près du feu mais on me refusa l’entrée. J’allai à la maison suivante mais l’on m’interdit de nouveau de m’approcher de la cheminée pour éviter de geler. La famille des hommes me traitait durement. Mais « Derrière une Providence irritée se cache un Dieu de charité », qui darda bientôt ses rayons de lumière sur mon indigne personne.
Le matin suivant, je marchais toujours, à bout de forces, faible, affamé, boitant, épuisé. Je voyais des gens prendre leur petit-déjeuner du bord de la route mais je n’osais pas entrer chez eux pour obtenir à manger et ne l’aurais fait pour rien au monde. En passant devant une chaumière, je vis la table du petit-déjeuner couverte d’une abondante nourriture et ne repérai aucun homme dans la maison ; la tentation était trop grande pour résister.
Voyant une femme près de la table, je me dis que si elle était encline à me dénoncer, il faudrait qu’elle me capture et me retienne, ce qui semblait impossible. Je m’approchai de la porte en me découvrant la tête et lui demandai si elle aurait la bonté de me vendre pour six pence de pain et de viande. Elle m’en coupa un morceau et me l’apporta ; je la remerciai et lui tendis l’argent mais au lieu de le prendre elle éclata en sanglots et s’exclama « Peu importe l’argent », tout en se détournant légèrement pour m’inciter à continuer mon chemin. C’était inattendu : j’avais rencontré une amie au moment où, cerné d’étrangers, j’en avais le plus besoin, et rien n’aurait pu me réconforter davantage au milieu des épreuves. Je repartis rempli d’un courage nouveau. La nuit suivante, je fis halte dans une auberge et continuai de m’arrêter dans des maisons publiques jusqu’à ce que mes réserves fussent presque épuisées. En arrivant au Grand Marais noir, dans le comté de Wood, dans l’Ohio, je m’arrêtai une nuit dans un hôtel après avoir marché toute la journée dans la boue et la neige ; je découvris vite que je n’arriverais pas à payer ma note. C’était l’époque où fleurissaient les banques libres et les planches à billets ; ils demandaient un dollar pour une nuit.
Lorsque je découvris cela, je sortis discrètement du bar pour aller dans la cuisine où la patronne préparait le dîner ; comme elle devait cuisiner pour un grand nombre de voyageurs, je lui proposai mes services pour la préparation du repas. Elle accepta volontiers et je me mis au travail. Elle fut très satisfaite de moi et le lendemain matin je l’aidai pour le petit-déjeuner.
Elle voulait m’embaucher pour tout l’hiver mais je refusai, par crainte d’être poursuivi. En guise d’excuse, je lui dis que j’avais un frère à voir à Détroit pour une affaire importante et qu’après l’avoir réglée je reviendrais travailler pour eux tout l’hiver.
Lorsque je partis le second matin, ils me payèrent cinquante cents en plus de ma pension, en pensant que je reviendrais ; mais je n’y suis pas encore retourné.
Le lendemain matin, j’arrivai dans le village de Perrysburgh, où je trouvai une importante colonie de gens de couleurs, dont beaucoup d’esclaves fugitifs. Je leur exposai ma situation et ils compatirent avec moi. J’étais un étranger mais ils m’accueillirent parmi eux et me persuadèrent de passer l’hiver à Perrysburgh, où je pourrais trouver du travail, et d’aller au Canada le printemps suivant, dans un vapeur partant de Perrysburgh, si cela me convenait. »
Henry Bibb, Narrative of the Life and Adventures of Henry Bibb, an American Slave, Written by Himself, New York, 1849, p. 50-55. Traduction française Hélène Tronc. Tous droits réservés.
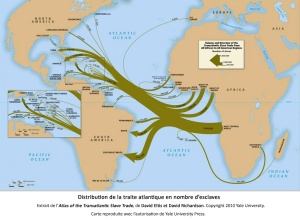
Commentaires fermés