Solomon Northup : Chasse à l’homme dans les bayous de Louisiane
« En regardant vers l’amont du bayou, je vis Tibeats et deux autres hommes chevauchant à vive allure, suivis d’une meute de chiens. Il y en avait huit ou dix. Je les reconnus malgré la distance : ils appartenaient à la plantation voisine. Les chiens utilisés pour traquer les esclaves à Bayou Bœuf sont des limiers, mais d’une race bien plus sauvage que ceux qu’on trouve dans les États du Nord. Ils attaquent les noirs sur ordre de leur maître et s’accrochent à eux comme les bouledogues aux quadrupèdes. On entend souvent leurs aboiements retentir dans les marais. On se demande alors quand un fugitif va être rattrapé, de même que les chasseurs new-yorkais s’arrêtent pour écouter leurs chiens courant sur les collines, et annoncent à leur équipier où le renard sera capturé. Je ne connais aucun esclave qui ait réussi à s’échapper vivant de Bayou Bœuf. Cela s’explique en partie par le fait que les esclaves n’ont pas le droit d’apprendre à nager et sont incapables de traverser la moindre rivière. Or leur fuite ne peut les mener très loin sans qu’ils rencontrent un bayou et soient confrontés à cet inévitable choix : se noyer ou se faire rattraper par les chiens. Dans ma jeunesse, je m’étais exercé dans les rivières limpides de ma région natale au point de devenir un nageur averti si bien que je me sentais à l’aise dans l’eau.
Je restai debout sur la barrière, jusqu’à ce que les chiens aient atteint la presse à coton. Quelques instants plus tard, leurs longs hurlements sauvages annoncèrent qu’ils étaient sur ma trace. Bondissant de mon poste d’observation, je me mis à courir vers le marais. La peur décuplait mes forces et j’en fis le meilleur usage. À intervalles rapprochés, j’entendais les glapissements de la meute. Les chiens gagnaient du terrain. Chaque aboiement était plus près que le précédent. À tout moment ils allaient me bondir sur le dos ; j’allais sentir leurs longs crocs se planter dans ma chair. Ils étaient si nombreux ; je savais qu’ils me tailleraient en pièces, qu’ils me feraient instantanément mourir d’effroi. Je suffoquais et, en m’étouffant à moitié, bredouillai une prière implorant le Tout-Puissant de me sauver, de me donner la force d’atteindre un bayou assez large et profond pour leur faire perdre ma piste ou pour m’engloutir. Au lieu de cela, j’atteignis un épais bosquet de palmiers nains. Ma course les fit bruire vivement mais pas assez pour couvrir les cris des chiens.
Continuant plein sud, autant que j’en pouvais juger, je parvins à un cours d’eau tout juste assez profond pour que mes chaussures soient immergées. Les limiers devaient être à moins de trente mètres de moi à ce moment-là. Je les entendais se ruer et bondir dans les palmiers ; le marais tout entier retentissait du bruit de leurs hurlements sonores et impétueux. Je repris un peu espoir en atteignant l’eau. Si seulement elle devenait plus profonde, ils perdraient peut-être perdre ma trace et, en hésitant, me permettraient de leur échapper. Par chance, plus j’avançais, plus je m’enfonçais : l’eau atteignit mes chevilles, je fus immergé jusqu’à mi-genou et brièvement jusqu’à la taille, avant d’émerger à nouveau. Les chiens n’avaient pas gagné de terrain depuis que j’avais pénétré dans l’eau. Ils étaient de toute évidence déroutés. Leurs jappements sauvages s’atténuèrent peu à peu, m’assurant que je m’éloignais d’eux. Je m’arrêtai enfin, pour écouter, mais l’air retentit soudain de longs hurlements. Je n’étais pas encore sauf. De mare en mare, ils pouvaient toujours suivre ma trace, sentir où j’avais posé le pied, même si l’eau les retardait. À ma grande joie, je finis par atteindre un bayou assez large. J’y plongeai aussitôt et, en luttant contre ses eaux stagnantes, atteignis bientôt l’autre rive. Les chiens s’égareraient certainement car le faible courant emporterait toute trace de la légère et mystérieuse odeur qui permet aux fins limiers de pourchasser les fugitifs.
Après la traversée de ce bayou, l’eau devint si profonde qu’il me fut impossible de courir. Je me trouvais dans ce qu’on appelle « le grand marais de Pacoudrie », comme je le découvris plus tard. Il est densément planté d’immenses arbres – sycomores, gommiers, peupliers et cyprès – et s’étend, d’après ce que j’ai appris, jusqu’aux berges de la rivière Calcasieu. Il est inhabité, sur trente ou quarante miles, hormis de bêtes sauvages – ours, chats sauvages, jaguars, et grands reptiles visqueux qui grouillent de toutes parts. Bien avant d’atteindre le bayou, en fait dès que je mis les pieds dans l’eau et jusqu’à ma sortie du marais au retour, je fus cerné de serpents. Je vis des centaines de mocassins d’eau. Ils pullulaient sur chaque branche, dans chaque mare, sur chaque tronc d’arbre gisant sur lequel je devais m’appuyer ou grimper. Ils s’éloignaient à mon approche mais parfois, dans ma hâte, je posais presque la main ou le pied dessus. Ce sont des serpents venimeux : leur morsure est plus mortelle que celle du serpent à sonnette. J’avais de surcroît perdu une chaussure, la semelle s’étant entièrement détachée, de sorte que seule la partie supérieure pendait à ma cheville.
Je vis aussi de nombreux alligators, petits et grands, dans l’eau ou sur les troncs flottants. En général, le bruit que je faisais les dérangeait tant qu’ils s’enfuyaient et plongeaient vers des eaux plus profondes. Parfois, je tombais nez-à-nez avec un de ces monstres. Je rebroussais alors chemin et faisais un léger détour en courant pour les éviter. Ils peuvent courir tout droit, sur de petites distances, mais sont incapables de tourner. Dans une course sinueuse, il n’est pas difficile de les distancer.
Vers environ deux heures de l’après-midi, j’entendis le dernier chien. Ils n’avaient sans doute pas traversé le bayou. Épuisé et trempé, mais soulagé de ne plus avoir à lutter contre un péril imminent, je poursuivis mon chemin, avec plus de prudence qu’au début de ma fuite mais une peur accrue des serpents et des alligators. Avant de faire un pas dans une mare boueuse, je sondais l’eau avec un bâton. Si elle bougeait, je la contournais ; sinon, je la traversais.
Le soleil finit par décliner et le manteau de la nuit enveloppa peu à peu le grand marais de son obscurité. Je continuai de marcher, vacillant et redoutant à chaque instant d’être mordu par un funeste mocassin d’eau ou broyé par les mâchoires d’un alligator que j’aurais dérangé. Ma peur de ces créatures égalait désormais presque celle des limiers qui m’avaient traqué. La lune se leva et sa lueur ténue se diffusa sous l’ample ramure chargée de longues mousses suspendues. Je marchai jusqu’à minuit passé, ne cessant d’espérer déboucher dans un lieu moins désert et dangereux. Mais l’eau devenait de plus en plus profonde, et la progression de plus en plus ardue. Je compris qu’il serait impossible d’aller beaucoup plus loin et que, de toute façon, j’ignorais entre quelles mains je tomberais si j’atteignais une habitation humaine. Dépourvu de laissez-passer, je serais à la merci de n’importe quel homme blanc, qui aurait le droit de m’arrêter et de me mettre en prison jusqu’à ce que mon maître « prouve son droit de propriété, paie les frais et m’emmène avec lui ». J’étais un animal égaré et, si par malchance je tombais sur un citoyen de Louisiane respectueux des lois, il estimerait peut-être qu’il était de son devoir envers son voisin de me jeter en prison sans attendre. Il était difficile de savoir ce que je devais redouter le plus : les chiens, les alligators ou les hommes !
Après minuit, je fis une pause. L’imagination elle-même ne saurait peindre une scène aussi désespérée. Le marais résonnait des cris d’innombrables canards. Selon toute probabilité, aucun homme avant moi n’avait foulé les recoins de ce marais depuis la création de la terre. Le silence, oppressant, ne régnait plus comme lorsque le soleil brillait dans les cieux. Mon intrusion nocturne avait réveillé les tribus emplumées qui semblaient peupler les marais par centaines de milliers, et leurs gorges bavardes émettaient tant de cris, ajoutés aux battements d’ailes et aux plongeons dans l’eau de tous côtés autour de moi, que j’étais affolé et terrifié. Toutes les bêtes qui volent et qui rampent semblaient s’être rassemblées dans cet endroit précis afin de le remplir de leur clameur et de leur remue-ménage. Le spectacle et le bruit de la vie ne se rencontrent pas seulement près des habitats humains ou dans les villes très peuplées ; les endroits les plus sauvages de la terre en regorgent. Même au cœur de ce marais sinistre, Dieu avait offert un habitat et un refuge à des millions de créatures vivantes.
La lune s’était élevée au-dessus des arbres lorsque je décidai de changer de plan. J’avais jusqu’alors tenté de progresser le plus loin possible vers le sud. Je changeai de direction et me dirigeai vers le nord-ouest, afin d’atteindre les bois de pins près de chez maître Ford*. Je me sentirais plus en sécurité sous son égide.
Mes vêtements étaient en lambeaux ; mes mains et mon visage, tout éraflés ; mon pied nu, hérissé d’épines. J’étais maculé de fange, de boue et de la vase verte qui flottait sur les eaux stagnantes dans lesquelles j’avais dû m’immerger maintes fois, de jour comme de nuit. »
Solomon Northup, Twelve Years a Slave : Narrative of Solomon Northup, a Citizen of New-York, Kidnapped in Washington City in 1841, and Rescued in 1853, Auburn (N.Y.), Derby and Miller, 1853, p. 136-142. Traduction française Hélène Tronc. Tous droits réservés.
* Maître Ford : précédent propriétaire de Solomon Northup, chez qui il avait moins souffert.
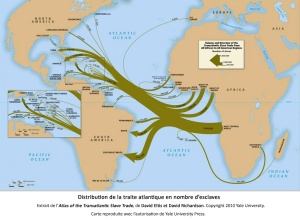
Commentaires fermés